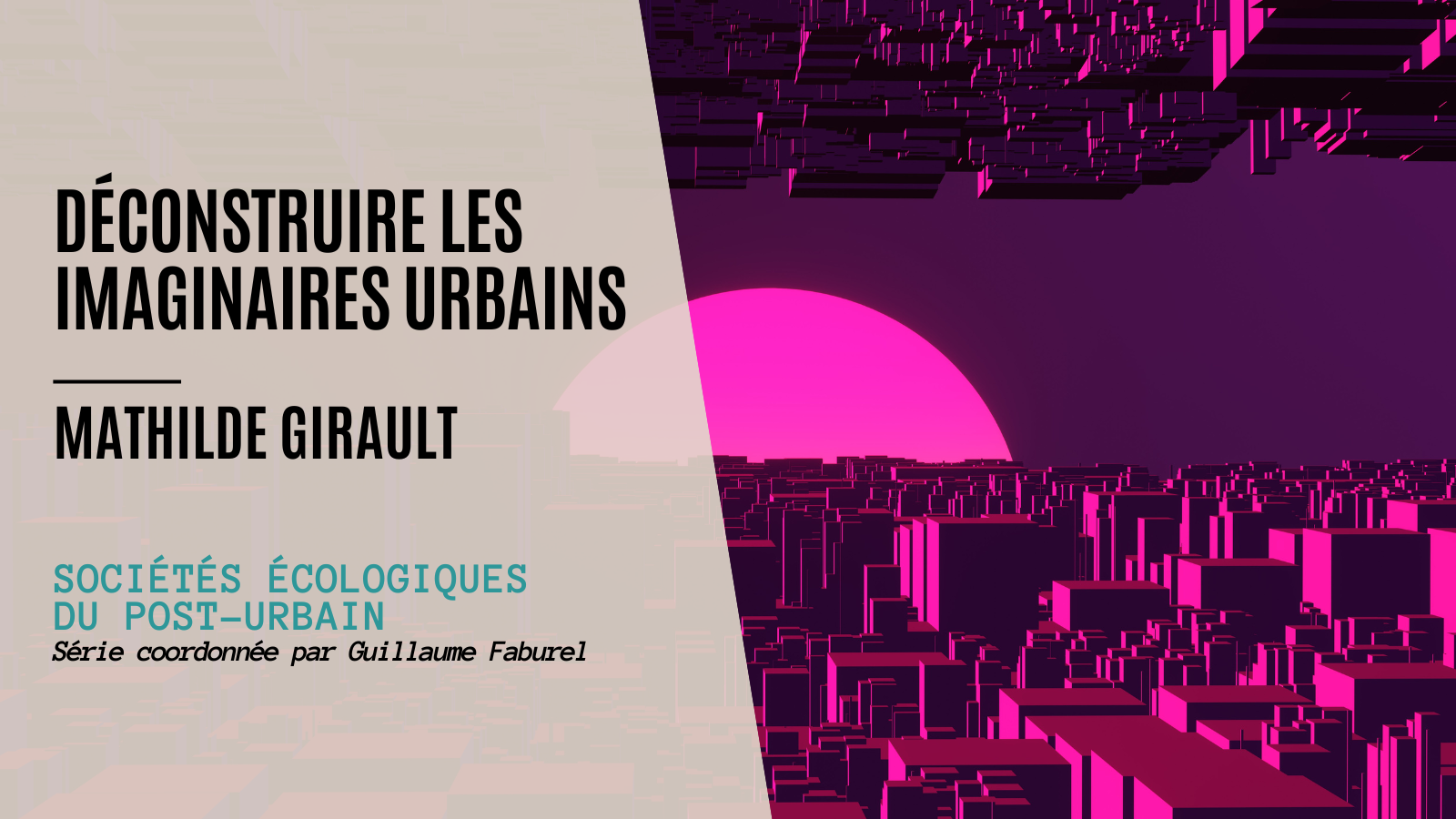Alors que, proportionnellement à leurs populations, les villes concentrent consommation d’énergie, production de déchets ou émission de gaz à effet de serre (cf. Faburel, 2019, pour la FEP, note n°13), l’urbain est toujours promu comme la seule solution pour répondre aux enjeux écologiques, notamment sous la forme récente de la « ville intelligente » (cf. Jarrige, 2020, pour la FEP, note n° 14). Economies d’échelle, efficience dans la gestion des ressources ou encore transformation écologique des modes de vie, les villes nourrissent tous les espoirs d’une transition des environnements et des modes de vie.
Pourtant, les annonces faites depuis les années 2000 d’un changement paradigmatique de l’urbanisme en réponse aux enjeux environnementaux (sous les traits momentanés d’un développement urbain durable) semblent de peu d’effets pour une mutation des expertises territoriales. Les environnements urbains ne cessent de se dégrader, tandis que des disparités spatiales se dessinent entre les pratiques environnementales des habitants en milieu urbain ou rural. Dès lors, le rôle prétendument salvateur des villes dans les scénarii et les politiques interpelle. Il semblerait y avoir quelques blocages à penser d’autres perspectives écologiques pour l’action territoriale que celles pensées pour le seul urbain. Parmi ces résistances, nos imaginaires associés à la (grande) ville semblent jouer un rôle fort.
Ces imaginaires posent l’urbain comme structurant (1) de notre compréhension des enjeux, (2) de nos représentations de l’avenir et (3) de nos modes d’action. Questionner ce méta-récit de l’urbain nous permet alors de libérer les débats et actions politiques pour la prise en compte du vivant et de la biodiversité, la renaturation des territoires et le besoin social de liens renouvelés à la terre. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les solutions proposées en dehors du méta-récit de l’urbain seraient nécessairement écologiques, mais il n’est plus à ce jour tenable de réaliser une transition écologique tant que l’urbain constitue notre seul opérateur réflexif du monde.
Télécharger la note au format Pdf :