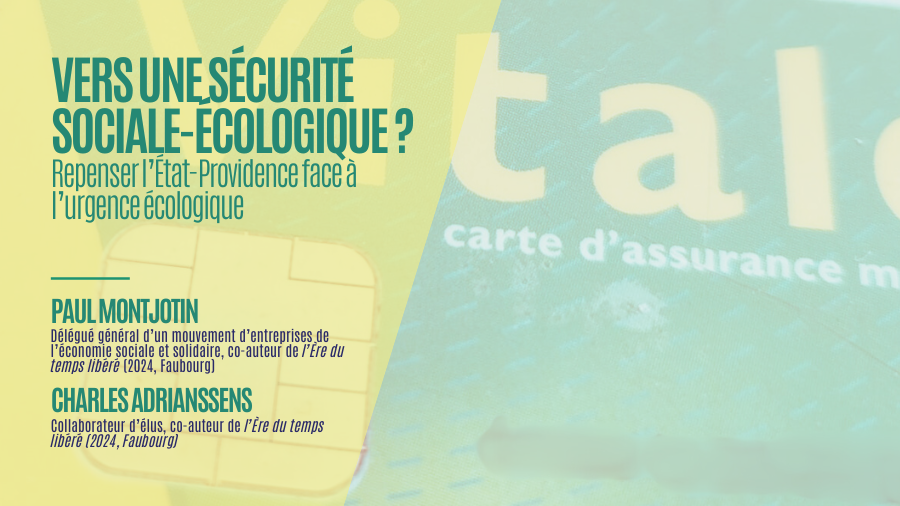Alors que nous célébrons les 80 ans de la création de la Sécurité sociale, cette note propose de dessiner un chemin nouveau pour faire face à l’urgence écologique, en s’appuyant sur des propositions s’inspirant des choix de 1945 et revendiquant le même niveau d’ambition. Il est vrai qu’à bien des égards, l’action publique semble ne pas s’être encore hissée à la hauteur des défis du XXIe siècle, notamment concernant le dérèglement climatique. Ces propositions esquissent un État-providence écologique, c’est-à-dire un Etat-providence renouvelé à l’aune de l’urgence écologique. Elles revêtent un sens particulier dans la période de backlash écologique inédit que traverse notre pays, alors même que 82% des Français.e.s estiment que l’Etat doit faire plus en matière de lutte contre le dérèglement climatique (1) et que plus de 2 millions de personnes ont signé la pétition contre la loi dite “Duplomb” à l’été 2025.
L’entrée dans le nouveau régime climatique provoque, comme cela fut le cas au XIXe siècle avec la révolution industrielle, un bouleversement de l’infrastructure matérielle de nos sociétés. Cette rupture appelle à repenser notre organisation collective et nos institutions. De même que la création de l’État social a permis de prendre en charge la révolution industrielle, l’affirmation d’un État écologique peut permettre de répondre aux enjeux du défi climatique. Souvent dépeint comme un fardeau, l’État-Providence peut au contraire constituer un formidable atout pour protéger les individus des bouleversements matériels liés au nouveau régime climatique et pour créer les conditions d’une transition écologique soutenable et juste. Cette extension du domaine de la Sécurité sociale avait même été prévue par ses premiers concepteurs, l’article 1er de l’ordonnance du 4 octobre 1945 promettant « d’étendre le champ d’application de l’organisation de la Sécurité sociale à des catégories nouvelles de bénéficiaires et à des risques ou prestations non prévus par les textes en vigueur » (2). C’est aussi un enjeu de pérennité financière de la Sécurité sociale, puisque les maladies chroniques, notamment générées par la pollution ou la dégradation de l’alimentation, pèsent de plus en plus considérablement sur les dépenses sociales. A titre d’exemple, la prise en charge du surpoids et de ses complications représente à elle seule un coût social évitable et direct de 8,1 milliards d’euros par an (3).
Comment réussir la métamorphose de notre État-Providence conçu pour prendre en charge la révolution industrielle et résoudre le conflit entre le travail et le capital en un État social-écologique adapté à l’impératif écologique et capable de réconcilier la question sociale avec le défi climatique ? C’est le sens de propositions s’inscrivant dans l’écologie politique qui esquissent une protection sociale écologique. Ces initiatives poursuivent deux logiques complémentaires, consubstantielles à la construction de l’État-Social : la prise en charge des risques d’une part et la réponse aux besoins essentiels d’autre part. Le défi de cet « État-providence écologique » est donc double : protéger les citoyens face aux conséquences du changement climatique d’une part et garantir l’acceptabilité sociale de la transition écologique d’autre part.
I. La prise en charge de nouveaux risques liés au dérèglement climatique
L’État-providence a été construit sur l’idée que les êtres humains ont le droit d’être « à l’abri des aléas de l’existence » selon les termes de Pierre Laroque, la Sécurité sociale apparaissant comme le prolongement logique de la sécurité civile. La création de la Sécurité sociale en 1945 a ainsi eu vocation à protéger les travailleurs et leur famille contre les grands risques sociaux liés à l’économie industrielle : accident du travail, maladie, vieillesse, famille, auxquels se sont ajoutés le chômage puis plus récemment la perte d’autonomie. Il convient ici d’avoir à l’esprit la nécessaire progressivité de la transition vers une Sécurité sociale écologique. Si la Sécurité sociale a bien été créée par un décret du 4 octobre 1945, celui-ci venait en réalité unifier des dynamiques multiples et anciennes : les mutuelles ouvrières initiées au 19e siècle, les premiers revenus minimums et caisses de retraites au début 20e siècles, les premières allocations familiales dans l’entre-deux guerres. De la même manière aujourd’hui, les très nombreuses initiatives écologiques citoyennes, publiques et privées, doivent converger pour créer un tout cohérent et intégré.
L’accélération de la crise écologique au 21e siècle fait naître des risques sociaux d’une nature nouvelle à travers par exemple la multiplication des risques d’inondations ou de canicules. A partir du moment où l’on reconnaît que le risque social comprend désormais une dimension environnementale forte, les citoyens sont en droit d’attendre que les risques liés au dérèglement climatique soient appréhendés comme des risques sociaux et que le périmètre de la Sécurité sociale soit étendu pour couvrir ces nouveaux risques. A cet égard, la colère des citoyens espagnols, qui ont accueilli le roi d’Espagne par des jets de boue, contre l’État à la suite des inondations meurtrières à Valence en octobre 2024, a rappelé combien le désir de protection face aux nouveaux risques écologiques était une aspiration universelle. Seule une véritable Sécurité sociale écologique peut permettre d’y répondre. Plusieurs propositions visant à couvrir les nouveaux risques liés au dérèglement climatique ont ces dernières années été défendues. Mises bout à bout, elles esquissent une Sécurité sociale-écologique.
a. Les nouveaux risques climatiques : l’exemple du retrait-gonflement des argiles
Une proposition de loi (4), portée par la députée Sandrine Rousseau, a été adoptée à l’Assemblée nationale en 2023 afin de mieux indemniser les dégâts provoqués par le retrait-gonflement des argiles sur les biens immobiliers. Ce phénomène, qui se caractérise par des mouvements des sols argileux et provoque des dégâts majeurs sur de nombreuses habitations, est étroitement lié au dérèglement climatique puisque les argiles se rétractent en cas de sécheresse et se gonflent sous l’effet de l’accumulation en eau en cas de forte pluviométrie. Alors que dix millions de maisons individuelles sont très exposées au risque de RGA, le mécanisme d’indemnisation de la garantie catastrophe naturelle n’est pas adapté et fait peser de ce fait sur les propriétaires les conséquences du réchauffement climatique. Ce texte proposait ainsi de faciliter l’indemnisation des victimes du RGA en élargissant les critères de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et en facilitant la reconnaissance du lien de causalité permettant d’obtenir une indemnisation au titre d’une catastrophe naturelle.
B. La nécessité d’une assurance sociale face aux risques de catastrophes naturelles
Plus largement, le régime d’indemnisation des catastrophes naturelles, instauré en France par la loi du 13 juillet 1982, dont le financement repose sur une surtaxe obligatoire sur les assurances de bien, n’apparaît plus suffisamment robuste pour faire face durablement au changement climatique. Selon, la Caisse centrale de réassurance, la sinistralité devrait augmenter d’environ 40 % à horizon 2050 en raison de la seule progression des aléas naturels. A titre d’exemple, le seul coût de la sinistralité « sécheresse » représentera 43 milliards d’euros entre 2020 et 2050 alors qu’il n’avait représenté que 13,8 milliards d’euros entre 1989 et 2020. Dans ce cadre, le renforcement du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles constitue une priorité. C’est le sens notamment de propositions formulées par les députés écologistes Tristan Lahais et Eva Sas dans le cadre du rapport d’information de juillet 2025 (5) sur les moyens consacrés à l’adaptation au changement climatique. Le rapport préconise notamment d’instituer un mécanisme permettant d’augmenter progressivement la surprime d’assurance, dont le niveau est passé de 12% à 20% au 1er janvier 2025, afin de garantir la stabilité financière du régime face à la multiplication des sinistres.
Le Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan a pour sa part proposé en juin 2025 une socialisation complète et universelle des risques climatiques affectant les logements, avec la création de branches dédiées : sécheresse, météo, zone inhabitable et prévention. L’ensemble des logements y sont affiliés automatiquement en substitution des assurances privées. Les financements interviennent par cotisation, avec une surcotisation pour les résidences secondaires et logements vacants. Le budget fictif de cette “Sécurité sociale climatique” pour l’année 2023 aurait été de 10 milliards d’euros (6). A moyen terme, la construction d’un système assurantiel plus robuste pour face à la fréquence et au coût croissants des catastrophes liées au changement climatique implique sans doute de mobiliser d’autres mécanismes de financement à travers par exemple la mise à contribution des énergies fossiles.
c. L’intégration progressive des risques climatiques dans le droit du travail
L’adaptation du droit du travail pour tenir compte des nouveaux risques sociaux liés au dérèglement climatique constitue un autre enjeu majeur de l’État providence écologique. C’est le sens de la proposition de loi visant à protéger les travailleurs de l’exposition aux températures extrêmes déposé par le député Hadrien Clouet (7) qui établit des seuils de température pour la santé humaine au travail en-deçà ou au-delà desquels l’inspection du travail est en droit d’imposer un arrêt temporaire de l’activité. Si la législation est encore lacunaire pour adapter les conditions de travail au changement climatique, les organisations syndicales et patronales s’emparent sur le terrain de ce sujet et des accords collectifs sont signés en ce sens. C’est le cas par exemple d’un accord d’Eram Logistique signé en 2022 qui met en place des mesures de prévention lorsque des seuils de chaleurs définis dans l’accord sont atteints. Ces accords comblent un vide et appellent le législateur à se saisir de ces sujets. L’adaptation du droit du travail au dérèglement climatique trouve un écho dans d’autres pays. C’est le cas en particulier en Espagne dont le gouvernement, en novembre 2024 à la suite des inondations meurtrières à Valence, a instauré un « congé payé climatique » de quatre jours, payé par l’État, pour éviter les déplacements en cas d’alerte des autorités publiques lié à un risque météorologique. Cette réforme constitue sans doute l’une des premières lois de Sécurité sociale écologique en Europe.
Plus largement, le droit du travail qui s’est progressivement construit à partir de la fin du 19e siècle autour de l’objectif de sécurité économique et matérielle doit désormais intégrer la responsabilité environnementale. Plusieurs propositions permettraient de faire évoluer le droit du travail en ce sens. A l’échelle des relations individuelles de travail, un “ droit de retrait écologique” est défendu en ce sens par certaines organisations syndicales (8) afin de permettre aux salariés de ne pas travailler sur un projet non conforme à des minima écologiques et sociaux tels que définis collectivement dans leur contrat de travail. Ce droit de retrait écologique est défendu comme une disposition complémentaire du statut de salarié lanceur d’alerte introduit par la Loi Sapin 2 (9). A l’échelle des relations collectives de travail, l’intégration des questions écologiques dans le dialogue social apparaît ensuite comme une nécessité pour placer l’urgence écologique au cœur des négociations sociales à tous les niveaux. Alors que les enjeux écologiques sont largement absents du dialogue social, une réforme profonde des relations collectives de travail, dans le prolongement de la loi Climat et résilience (10), pourrait permettre aux salariés de s’emparer davantage de ces enjeux. En particulier, des négociations climatiques obligatoires, dans la philosophie des lois Auroux de 1982, pourraient être instaurées dans les grandes entreprises et les moyens des élus du CSE sur les questions écologiques pourraient être renforcés (11).
D. Un droit à la reconversion écologique face aux bouleversements de l’emploi
La transition écologique génère enfin des risques sociaux liés au bouleversement de l’organisation productive et de la structure de l’emploi. Certains secteurs vont être amenés à croître avec des gisements d’emplois significatifs tandis que d’autres sont condamnés à décroître fragilisant alors des emplois existants. Face à ces mutations de l’emploi, une Sécurité sociale professionnelle pourrait permettre de garantir un véritable droit à la reconversion pour tous les actifs dont la transition viendrait détruire les emplois. L’idée de Sécurité sociale professionnelle, défendue notamment par la CGT, consiste à garantir la continuité des droits et de la rémunération des travailleurs tout au long de leur vie, indépendamment de leur statut ou de leur contrat. Alors que l’accès à la formation des demandeurs d’emploi est deux fois plus faible que pour les personnes en emploi, la création d’un droit universel à la reconversion permettrait d’y remédier. Dans l’esprit du dispositif “Projet de transition professionnel”, ce droit à la reconversion écologique pourrait s’articuler autour d’une double garantie : garantie de prise en charge d’un parcours de formation certifiant de longue durée sans reste à charge, garantie de maintien de rémunération pendant toute la durée de formation.
II. La satisfaction des conditions environnementales d’existence
Au-delà de la prise en charge de nouveaux risques, la sécurité sociale doit se doter d’une dimension environnementale parce que le bien être humain est étroitement déterminé par les conditions environnementales d’existence. De manière positive ou négative à travers par exemple l’exposition à la pollution de l’air, responsable de plus de 20 000 décès par an en France et dont l’impact varie considérablement en fonction de la qualité du logement et des espaces urbains. L’État-Providence écologique a donc vocation à couvrir les besoins essentiels à toute condition de vie digne et qui recouvrent notamment, l’accès à l’eau, à une alimentation saine ou encore au logement.
A. La Sécurité sociale de l’alimentation : une idée qui fait son chemin
De nombreuses études scientifiques, comme les rapports du Haut Conseil de la santé publique, convergent pour souligner le rôle majeur de l’alimentation comme déterminant de la santé. En particulier, les méfaits de la malnutrition sont désormais connus et étayés par une large littérature scientifique. On estime que 11 millions de personnes meurent chaque année dans le monde du fait d’une mauvaise alimentation, principalement du fait de maladies cardiovasculaires, du cancer et du diabète de type 2. La France n’est pas épargnée par l’essor de la malnutrition et l’explosion de l’obésité – dont le coût a été évalué à 20 Milliards d’euros par an (12) – en particulier du fait de l’augmentation de la part des produits transformés qui concernent près de 80% des dépenses alimentaires des ménages selon une étude de l’ANSES (13). Récemment, une étude coordonnée par l’Inserm, le CNRS et l’université Côte d’Azur (14) a mis en exergue les risques sanitaires liés à la consommation de produits ultra-transformés à travers une prise de poids rapide et importante, une dégradation de la santé cardio-métabolique, une perturbation de l’équilibre hormonal ou encore l’altération de la fertilité masculine.
Dans ce cadre, alors que plus d’un français sur deux considère qu’il est trop cher de manger équilibré, la Sécurité sociale du 21e siècle pourrait se fixer comme objectif de favoriser l’accès du plus grand nombre à une alimentation saine. C’est le sens du projet d’une « Sécurité sociale de l’alimentation », portée depuis plusieurs années par la société civile rassemblée dans le « collectif pour une Sécurité sociale de l’alimentation » et qui consisterait à intégrer l’alimentation dans le régime général de la Sécurité sociale à travers la création d’une nouvelle branche afin de garantir à tous les citoyens un accès universel et inconditionnel à une alimentation choisie, de qualité et durable. En France, une trentaine de projets de territoire expérimentent, avec le soutien de collectivités territoriales, des systèmes de Sécurité sociale alimentaire à travers la mise en place de caisses locales de l’alimentation, gérés de manière démocratique et reposant des cotisations citoyennes. Une proposition de loi « d’expérimentation vers l’instauration d’une Sécurité sociale de l’alimentation » (15) portée par les députés écologistes et examinée mais non adoptée en février 2025 visait à instaurer un fonds national d’expérimentation afin de soutenir toutes les initiatives locales de Sécurité sociale alimentaire en France.
Dans un autre registre, la ville de Strasbourg expérimente depuis novembre 2022 le droit à une alimentation saine pour les femmes enceintes à travers le dispositif des «ordonnances vertes» afin de limiter leur exposition aux perturbateurs endocriniens pendant leur période de grossesse. Concrètement ce dispositif d’ « ordonnance verte » permet aux femmes enceintes habitant Strasbourg de recevoir des paniers de légumes bio gratuits pour une durée de 2 à 7 mois et de bénéficier d’ateliers de conseils et prévention contre les perturbateurs endocriniens. Les légumes proviennent d’une ferme située à proximité de Strasbourg et qui a été retenue dans le cadre d’un marché public. En plus de la participation financière directe de la ville de Strasbourg, le dispositif est cofinancé désormais par l’ARS et le régime local d’assurance maladie Alsace-Moselle. L’évaluation de cette expérimentation se révèle particulièrement positive : 90 % des bénéficiaires déclarent vouloir manger bio à la fin du dispositif. Au-delà des femmes concernées par les « ordonnances vertes », ce dispositif offre un levier de sensibilisation et d’éducation alimentaire à l’ensemble du foyer.
Au regard de ce bilan positif, la municipalité de Strasbourg a annoncé en septembre 2023 la pérennisation de ce dispositif. A ce titre, cette expérimentation locale pourrait également demain être étendue à l’échelle nationale et s’inscrire dans le régime de base de la sécurité sociale. C’est d’ailleurs le sens d’une proposition de loi (16) déposée par la députée écologiste Sandra Regol visant à généraliser le dispositif de l’ordonnance verte expérimenté à Strasbourg.
B. Demain, un service public national de l’eau ?
Alors que l’eau est par nature un élément essentiel à toute forme de vie sur terre, la raréfaction de la ressource en eau, en France en particulier, fait naître des risques nouveaux. Si l’eau douce paraît abondante à l’échelle de la France, elle est néanmoins en diminution. Un rapport de France Stratégie (17) révèle à cet égard qu’entre les périodes 1990-2001 et 2002-2018, le volume d’eau disponible a baissé de 14 % (– 33 milliards de mètres cubes) essentiellement du fait de la baisse des précipitations et de l’augmentation de l’évapotranspiration favorisée par des températures plus élevées.
Dans ce cadre, il apparaît que l’eau ne peut plus être gérée comme une marchandise. C’est le sens de la tarification progressive de l’eau potable mise en place par la métropole de Lyon afin de faciliter l’accès à l’eau potable des publics plus précaires et de lutter contre le gaspillage de l’eau, avec un objectif de 15 % de baisse de consommation d’ici 2035, dans un contexte de forte tension sur la ressource en eau. Ce nouveau système tarifaire a pour ambition de garantir un « accès universel » à l’eau potable en rendant les 12 premiers mètres cubes gratuits. D’autres collectivités ont avancé dans cette direction, comme Montpellier ou Dunkerque.
Pour ce faire, la mise en place de régies publiques locales de l’eau est souvent un préalable nécessaire, bien que chaque territoire ait une réalité spécifique et que la transition du secteur privé vers le secteur public se pose à chaque fois différemment. C’est le cas de la métropole de Lyon depuis 2023, de la ville d’Arcueil à qui a participé en 2024 à la création d’une régie commune nommée “Eau Seine & Bièvre” avec huit autres villes du Val-de-Marne, de la Ville de Paris avec Eaux de Paris depuis 2009 ou même de la métropole de Nice depuis 2014. Ces collectivités d’horizons très divers expliquent ce choix par une exigence commune de garanties en matière de santé environnementale, de transparence démocratique et d’une gestion non-spéculative de la ressource.
Cette tarification sociale de l’eau et ce mouvement des territoires vers la régie publique esquissent les contours de ce qui pourrait constituer un jour un service public national de l’eau. Pour y parvenir, l’Etat pourrait endosser le rôle de facilitateur du développement d’un réseau public par les collectivités et de centre de ressources de compétences et de formation professionnelle.
c. Vers un droit au logement écologique
Le mal-logement touche 4 millions de personnes en France en 2025 (18) et 30% des Français.e.s ont eu froid dans leur logement en 2024 (19). Cette réalité renvoie à des logements disponibles en nombre insuffisant, ainsi qu’à une rénovation énergétique limitée. Alors que le logement constitue un levier majeur de la lutte contre le dérèglement climatique et que le respect d’un objectif de zéro artificialisation nette ou brute est indispensable, la justice sociale et environnementale convergent pour motiver un vaste plan pour un droit au logement écologique. 71 ans après la crise de l’hiver 1954 et 18 ans après la création du droit au logement opposable (DALO), le droit au logement écologique permettrait d’assurer à chaque personne la possibilité d’accéder à un logement abordable, adapté à ses besoins, sobre énergétiquement, protégeant sa santé et s’inscrivant de manière respectueuse dans son environnement.
Pour rendre effectif ce droit, les conditions matérielles à réunir nécessitent un investissement public et privé partagé dans la réhabilitation et la construction de logements. La Ville de Lyon apparaît comme un laboratoire inspirant. La nouvelle “Stratégie pour le logement et l’habitat” (20) adoptée par la municipalité en lien avec la Métropole en 2024 fait progresser le nombre de logements, dans des formats divers et aux meilleurs normes écologiques, tout en désartificialisant les sols et en ciblant les publics les plus fragiles. Pour y parvenir, la municipalité a augmenté d’un tiers les investissements au Plan Pluriannuel d’Investissement pour le logement, lancé le Bail Réel Solidaire pour la primo-accession, adopté une Charte qualité urbaine particulièrement exigeante, mis en oeuvre l’encadrement des loyers, rendu obligatoire le permis de louer sur certains quartiers et doit atteindre en 2026 pour la première fois 25% de logement social conformément à la loi SRU. Ce volontarisme a permis à la ville d’être désignée par l’Union européenne comme l’une des 100 villes européennes, avec Bordeaux et Grenoble notamment, pouvant être neutres climatiquement à l’horizon 2030. Le droit au logement écologique y est donc déjà une réalité en germe.
Une déclinaison nationale peut en être issue. A titre d’exemple, lors de la campagne présidentielle de 2022, la candidature des Écologistes proposait la construction de 140 000 logements sociaux par an et la réhabilitation de 160 000 logements par an pour un coût annuel estimé à 5 à 12 milliards supplémentaires. Le candidat proposait également la rénovation thermique de l’habitat privé existant, soit environ 10 millions de logements, représentant un coût total de 50 milliards d’euros à répartir entre les acteurs et à étaler dans le temps. A la clé, une réduction de la facture énergétique de 600 à 700€ par an pour chaque foyer.
Conclusion : L’extension écologique de la sécurité sociale : un projet politique pour le XXI siècle
Malgré les attaques dont elle fait l’objet, la “Sécu” reste très largement plébiscitée par les Français.e.s (21). La crise du Covid-19 a d’ailleurs renforcé ce lien (22). L’adhésion toujours massive de la population à notre modèle de protection sociale doit nous inviter non seulement à la défendre et l’approfondir dans son périmètre actuel, mais aussi à l’étendre à la prise en charge du défi climatique. Cette extension écologique du domaine de la Sécurité sociale et de l’État-Providence apparaît comme un chantier majeur, dans un contexte où l’économie française et mondiale se heurte aux limites planétaires. Il est certain que cette extension de la Sécurité sociale ne pourra se faire que de manière progressive. Mais à bien des égards, cette évolution est déjà aujourd’hui en germe. Par exemple, à travers les collectifs citoyens de la Sécurité sociale de l’alimentation, les collectivités locales qui expérimentent les régies de l’eau ou encore les organisations syndicales qui s’emparent de plus en plus des enjeux écologiques dans le monde du travail. Un fourmillement qui évoque les dynamiques sociales à l’œuvre avant 1945 et qui ont porté la création de la Sécurité sociale. Les sciences sociales ont en effet souligné combien la multiplication des initiatives de secours mutuel et de caisses de solidarité dans le monde ouvrier tout au long du XIXe siècle ont poussé les pouvoirs publics à les soutenir, puis à construire leurs propres mécanismes institutionnalisés durant la première partie du XXe siècle (23). Le Conseil National de la Résistance, le ministre Ambroise Croizat et le haut-fonctionnaire Pierre Laroque venant porter et réaliser l’unification de ces initiatives déjà existantes. Suivant ce cheminement, il nous appartient d’inventer le nôtre vers une Sécurité sociale-écologique.
NOTES
(1) ADEME, “Climat : les Français attendent une plus grande implication de l’État”, février 2024
(2) Anne-Laure Beaussier, Tom Chevalier, Aurore Fransolet, Eloi Laurent, Matteo Mandelli, Bruno Palier, “Les crises écologiques nourries par nos systèmes économiques insoutenables vont déstabiliser nos protections sociales”, Le Monde, 14 juin 2025
(3) OCDE (2019), “The Heavy Burden of Obesity: The Economics of Prevention, OECD Health Policy Studies”, OECD Publishing, Paris, 2019 https://doi.org/10.1787/67450d67-en.
(4) Proposition de loi n°887 du 21 février 2023 visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement des argiles
(5) Rapport d’information sur les moyens consacrés à l’adaptation au réchauffement climatique
(6) Mathilde Viennot, Marine de Montaignac, Alice Robert,“Repenser la mutualisation des risques climatiques”, Haut-commissariat à la Stratégie et au Plan, juin 2025
(7) Proposition de loi n°2124 visant à protéger les travailleurs de l’exposition aux températures extrêmes
(8) Cette proposition est notamment défendu par l’éco-syndicat “Le printemps écologique”
(9) Loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
(10) Loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
(11) Institut Rousseau, 2024, “ négocier la transition écologique : du dialogue social au dialogue écologique “
(12) Direction générale du Trésor, 2016, « obésité : quelles conséquences pour l’économie »
(13) Avis de l’ANSES, Étude individuelle nationale des consommations alimentaires 3
(14)Le monde, Stéphane Foucart, Les aliments ultra-transformés ont des effets négatifs forts sur la santé en quelques semaines
(15) Proposition de loi n°386 du 15 octobre 2024 d’expérimentation vers l’instauration d’une sécurité sociale de l’alimentation
(16) Proposition de loi n°258 du 17 septembre 2024 instaurant une ordonnance verte
(17) France Stratégie, janvier 2025, la demande en eau : prospective territorialisée à horizon 2050
(18) Fondation pour le Logement, L’état du mal-logement en France, 2025
(19) Médiateur national de l’énergie, Baromètre énergie-info 2024 du médiateur national de l’énergie, 2024
(20) Ville de Lyon 9e, “La Stratégie logement et habitat de la Ville de Lyon”, 2024 https://mairie9.lyon.fr/actualite/cadre-de-vie/la-strategie-logement-et-habitat-de-la-ville-de-lyon
(21) Ipsos-Cesi, Les Français et la Sécurité sociale d’aujourd’hui et de demain, 2025
(22) Harris Interactive, Baromètre 2020 « Les Français et la Sécu », 2020
(23) P. Grelley, « La protection sociale avant la « Sécu » », Informations sociales, 2015