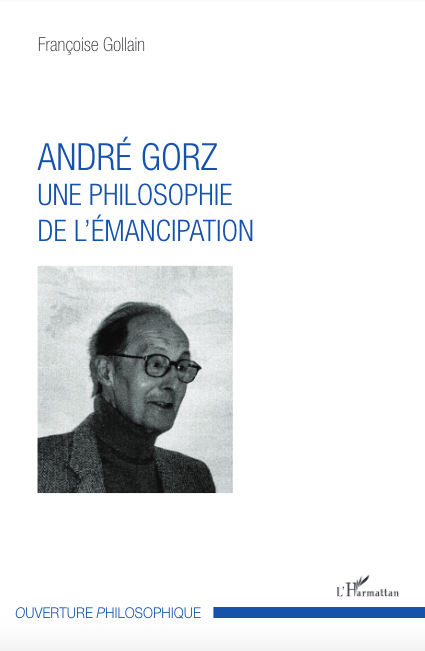Spécialiste reconnue de la pensée et de l’œuvre d’André Gorz, Françoise Gollain a beaucoup écrit à son sujet, à commencer par Une critique du travail, entre écologie et socialisme, suivi d’un entretien avec André Gorz, publié en 2000 aux éditions de La Découverte. Elle vient de publier un nouvel ouvrage dont l’ambition est d’« inscrire André Gorz dans la postérité en tant que philosophe » (p. 13). La question n’est pas celle de sa contribution à la philosophie comme discipline académique (qu’il n’a pratiquée qu’en autodidacte), il s’agit de faire voir, dans la rencontre de Gorz avec la philosophie de Sartre, et plus généralement avec la phénoménologie, ce qui a guidé sa vie et ses engagements politiques et sociaux et a fourni un fil conducteur à sa réflexion. En suivant de la sorte les étapes de l’itinéraire intellectuel d’André Gorz, Françoise Gollain ne complète pas seulement la biographie de Willy Gianinazzi (André Gorz, Une vie, La Découverte, 2016), elle permet de comprendre ce qui a mené Gorz du socialisme de son époque (dominé par la référence marxiste) à l’engagement écologique. Mais l’écologie politique d’André Gorz est paradoxale : car, si l’originalité de son projet de société est incontestable, et bien en phase avec les préoccupations actuelles, ce qui permet de le nommer à proprement parler écologique, pose problème. Et cette ambiguïté n’est pas réservée au seul André Gorz, elle est partagée, nous semble-t-il, par une grande partie des courants intellectuels ou politiques qui, en France, se réclament de l’écologie politique. D’où le très grand intérêt du livre de Françoise Gollain.
« L’exode de la société du travail »
Comme un certain nombre de ses contemporains, André Gorz a trouvé dans l’existentialisme de Sartre ce qui lui permettait d’éclairer sa propre vie : il a commencé par une autobiographie, Le Traître, publié en 1958. Mais il a été également de ceux (beaucoup plus rares) qui ne s’en sont pas tenus à L’Être et le Néant, mais sont passés de l’individuel au collectif et ont cherché dans la Critique de la raison dialectique de quoi comprendre la société de leur temps sur fond de ce qui était, pour Sartre, « l’horizon indépassable de notre époque », le marxisme. Après Le Traître, et une réflexion de morale individuelle, Gorz se tourne ainsi vers la réalité sociale et économique, dans ses articles de journaux comme dans les livres qu’il publie sous le nom de Gorz ou sous un autre pseudonyme, celui de Michel Bosquet : Stratégie ouvrière et néocapitalisme (1964), Critique du capitalisme quotidien (1973), Critique de la division du travail (1973). Confronté au marxisme, Gorz reste donc existentialiste : la philosophie de la liberté qui l’a guidé dans son interrogation sur lui-même reste le fil conducteur de son examen de la situation sociale. Il s’agit de d’inscrire le sujet et la liberté dans l’objectivité et la nécessité marxistes. Là où les marxistes, mais également les sociologues, étudient des structures ou des fonctions, Gorz est en « quête de sens ». En conséquence, pour lui, le socialisme vise la liberté, une « liberté supérieure » (p. 192), plutôt que la productivité. Ne compte pas seulement la répartition rationnelle de richesses produites en plus grandes quantités (p. 273), c’est la liberté qui importe. Aussi, pour Gorz, ne suffit-il pas de dénoncer l’exploitation (l’appropriation de la plus value créée par le travail ouvrier), il faut lutter contre l’aliénation (qui rend les résultats de son travail étrangers au producteur, et que Gorz retrouve dans le pratico-inerte de la Critique de la raison dialectique).
Or si l’aliénation -telle que l’étudiait Marx dans ses textes de jeunesse- se produit dans le travail, elle ne concerne pas seulement celui-ci, mais affecte l’ensemble du monde vécu. C’est pourquoi, pour Gorz, le socialisme ne doit pas consister à se libérer dans le travail, mais à se libérer du travail. Tel est, selon Françoise Gollain, le premier « tournant » dans la pensée de Gorz : cela le conduit à faire ses Adieux au prolétariat (1980). Il ne s’agit pas d’une rupture, on est toujours dans la liberté, mais le lieu en est déplacé. Le marxisme place la libération dans la réappropriation par le prolétariat des moyens de production : à l’opacité du marché doit succéder la transparence de la planification. Or, comme l’établit Gorz dans les Métamorphoses du travail (1988), cette transparence est impossible. L’utopie des « producteurs librement associés », réglant entre eux l’organisation du travail, implique une régression à une forme de communauté primitive, dans laquelle l’individu se résorbe. Or cette impossible coïncidence de l’individuel et du social, Gorz l’a toujours dénoncée comme une imposition autoritaire. L’opposition entre capitalisme et socialisme ne se fait donc pas au sein de la rationalité économique, elle oppose l’hétéronomie du système économique (quel qu’il soit) à l’autonomie des activités libres, non productives. L’objectif est donc de réduire la part du système et de l’hétéronomie, pour développer, hors de la sphère marchande, celui de l’autonomie, au sein du monde vécu.
Le travail (entendu comme activité publique mesurable et à visée d’efficacité) n’est pas au centre du socialisme à venir. Ce n’est déjà plus le cas, dans la société actuelle, telle que Gorz l’a vue se transformer. « Tant que la majorité de la population reste opprimée et exploitée dans son travail, explique Françoise Gollain, et non pas marginalisée et sous prolétarisée par la suppression du travail » (p. 92), la lutte se concentre sur l’exploitation salariale. Mais l’exclusion l’a emporté sur l’exploitation : le problème principal est celui de la diminution du volume de l’emploi. Avec la mondialisation, on n’assiste pas tant à une salarisation de masse, qu’au phénomène planétaire d’une production de masse d’individus en trop qui n’ont aucun espoir d’intégration au marché mondial comme producteurs ni comme consommateurs (p. 272). Il ne s’agit pas alors de chercher à rétablir le plein emploi, ni même à partager le travail en en réduisant le temps, il faut dégager des zones libérées de l’obligation productive, étendre la sphère de l’autonomie, donner aux exclus du travail la possibilité de choisir les activités qui leur conviennent. C’est ce qui conduit Gorz, d’abord hostile au revenu universel, à s’y rallier et à accepter la déconnexion entre revenu et travail.
Ces « métamorphoses du travail » adviennent dans une modernité où la technique a une place importante. Gorz n’est pas technolâtre (il critique vigoureusement, à la fin de sa vie, le posthumanisme et le projet d’amélioration biotechnologique de l’espèce humaine). Mais il n’est pas non plus technophobe : il ne rejette pas la technique comme telle, mais, à la suite d’Ivan Illich, distingue entre les techniques « conviviales », qui renforcent l’autonomie, et celles qui accentuent l’hétéronomie : c’est le cas, par exemple du nucléaire, affirmation de puissance politique qui repose sur le contrôle centralisé et le secret. Dans la société capitaliste, les développements technologiques sont le plus souvent récupérés à des fins de contrôle social et d’imposition de pouvoir, mais ils ouvrent également des opportunités qui peuvent être orientées du côté de l’autonomie. La technique est ainsi une condition du changement social.
Pour bénéficier de l’autonomie non marchande, il faut être sorti de la rareté originelle. Le paysan ou l’artisan des sociétés anciennes sont certainement plus autonomes, plus maîtres de leur travail que l’ouvrier fordiste, simple instrument de la machine. Mais ils doivent travailler toute la journée pour pourvoir à leur subsistance, ils sont soumis à la nécessité. Seul le développement technique, en accroissant la productivité, réduit le temps consacré à la production du nécessaire, et ouvre la possibilité de l’autonomie.
Mais, parce que la technique est la condition de l’autonomie, elle est aussi la raison pour laquelle on ne peut complètement supprimer l’hétéronomie. Devenues des « machines complexes », les sociétés sont des totalités complexes qui réunissent des sous-systèmes distincts, et cette complexité est indépassable. On ne peut donc éviter un certain maintien de l’hétéronomie et, ce, pour des raisons de complexité technique. La critique de la planification centralisée inclinerait Gorz du côté de l’autogestion, de la prise en main de leurs activités par de petits groupes de travailleurs unis par un projet commun, mais un certain nombre d’activités sont d’une technicité telle qu’elles ne peuvent être effectuées qu’à des échelles plus larges. Il ne s’agit donc pas tant de supprimer l’hétéronomie que de la réduire, pour laisser la place à une sphère autonome d’activités qui sont à elles-mêmes leur propre fin.
Gorz réfléchit dans une société hautement technicisée, où sont installées l’automation, l’informatique, l’intelligence artificielle. Ces développements techniques ne modifient pas seulement la composition organique du capital (le rapport entre capital constant –accumulé dans les machines- et capital variable –les salaires), ils font même disparaître la loi de la valeur. Tel est, selon Françoise Gollain, le « deuxième tournant » dans la pensée de Gorz : le postfordisme (la fin du travail posté, l’automation) est aussi un postmarxisme. C’est la technique, non plus le travail vivant qui est la source principale de richesse. A partir du moment où l’intelligence, avec la technique, devient une force productive, il n’y pas de mesure possible d’un temps de travail socialement nécessaire (L’Immatériel, connaissance, valeur et capital, 2003). Le travail n’est plus la substance de la valeur, il n’est plus au centre de la société. Il ne s’agit pas de remplacer le travail par la technique, mais d’entamer l’« exode de la société du travail » (p. 297), en complétant l’hétéronomie par l’autonomie, en passant d’une société de la technique à une société de la culture.
Ce qui fait la continuité de la pensée de Gorz c’est sa critique constante du productivisme et de l’économicisme (au sens de l’extension des rapports marchands, et de l’hégémonie de la rationalité instrumentale, celle de l’efficacité). Dès 1973, il affirmait : « nous pourrions vivre mieux en produisant moins à condition de travailler, de consommer et de vivre autrement » (p. 100). Le rejet du productivisme fait sa différence avec des héritiers du marxisme comme Negri (p. 298) et le conduit à dessiner les contours d’une société non productiviste : « Une autre économie et une autre société qui demandent désormais à naître, dans lesquelles le travail de production n’occupe qu’une place subordonnée. » (cité p. 298). Il qualifie ainsi de « décroissance » le rétrécissement de l’hétéronomie, c’est-à-dire de la sphère marchande régie par la rationalité économique, au profit de l’autonomie. Cela permettrait la restriction de la dynamique de l’accumulation capitaliste accompagnée de la réduction par autolimitation de la consommation.
Dans les réformes sociales examinées par Gorz (partage du temps de travail, RTT, revenu universel, salaire ou non de la femme au foyer…), on retrouve les préoccupations actuelles d’une gauche non productiviste, d’une gauche qui, comme lui, prend ses distances par rapport à la centralité du travail. Mais cette gauche peut-elle être dite écologiste ?
Une écologie politique paradoxale
Gorz est considéré comme « l’un des premiers artisans de l’écologie politique en France » (Gianinazzi, p. 200). Dans les années 1960-1970, l’alerte écologique est devenue globale, avec en 1962, le livre de Rachel Carson sur les méfaits du DDT, l’attention portée à la démographie galopante à la fin des années 1960, la mise en cause de la croissance illimitée avec le rapport Meadows en 1972…. C’est alors que Gorz rencontre André Hervé, responsable de la branche française des Amis de la Terre récemment créée, et va, avec celui-ci, participer à la mise en place du Sauvage, rejeton écologique du Nouvel Observateur. Il y publie des articles qu’il reprend en 1975 dans le recueil Ecologie et politique (publié d’abord sous le nom de Michel Bosquet, puis en 1978 sous les deux noms) Suivront Ecologie et liberté (1977), Capitalisme, socialisme, écologie (1991), Ecologica (2008).
L’écologie d’André Gorz, écrit Françoise Gollain, a été « d’emblée politique » (p. 131). Elle veut dire qu’elle n’a pas été environnementale : Gorz s’est fort peu préoccupé de la protection de la nature, voire même s’y est opposé, y voyant une forme de régression pétainiste. Mais cela veut dire aussi qu’il s’est très peu intéressé à la dégradation croissante des relations des humains avec leur milieu naturel. La très grande curiosité avec laquelle il suit les développements technologiques et les mouvements sociaux qui s’y réfèrent (mouvement des logiciels libres, hackers) contraste avec le peu de place qu’il accorde dans ses écrits à ce que l’on qualifie de crise écologique. Au-delà de l’épuisement des ressources qu’il semble avoir retenu du rapport Meadows, il y a la montée des pollutions et des risques industriels, la mobilisation internationale autour du changement climatique, l’érosion de la biodiversité… Tout cela reste pour lui des phénomènes extérieurs, des limites externes par rapport auxquelles il privilégie la dynamique interne des contradictions sociales (p. 317) : la logique capitaliste et autoritaire qu’il voit à l’œuvre dans le choix nucléaire a pour lui plus d’importance que la critique environnementale des pollutions ou des risques d’accident (p. 126).
Entre dynamique sociale et limites externes, la véritable écologie est, selon lui, du côté de la société. Gorz distinguait deux écologies : une écologie scientifique qui résultait de l’intégration, par le capitalisme, d’un certain nombre de contraintes écologiques, scientifiquement identifiées, et une écologie politique, celle d’un projet social et démocratique non productiviste, dans lequel les références écologiques (au sens de l’écologie scientifique) restaient secondaires. Non seulement l’interne prime sur l’externe, mais il le précède. Gorz n’a pas attendu sa rencontre avec les Amis de la Terre et la connaissance des dégradations environnementales pour développer une critique interne des logiques de l’hétéronomie. Le mouvement écologique est pour lui de nature politique et culturelle plutôt que strictement scientifique, il a surgi « d’une protestation spontanée contre la destruction de la culture du quotidien par les appareils de pouvoir économique et administratif » (Gorz, cité p. 220). Le rapport Meadows et la mise en évidence des limites externes de la croissance ont pu confirmer la critique interne du capitalisme, ils ne l’ont pas provoquée. L’exigence culturelle de l’écologie politique précède, logiquement et chronologiquement, la détermination scientifique des limites naturelles. La protection de la nature est subordonnée à la défense du monde vécu, de la sphère d’autonomie.
En présentant la distinction entre écologie scientifique et écologie politique comme une distinction de l’externe et de l’interne, qui ne prend son sens que dans l’opposition entre deux modèles sociaux (capitalisme et socialisme), Gorz semble avoir sous-estimé et la gravité de la menace écologique et la capacité du capitalisme à lui donner une place. Depuis au moins 1992 et le premier Sommet de la Terre ce à quoi on a assisté, c’est soit au déni pur et simple de la crise (le climatoscepticisme) soit, avec le développement durable ou la croissance verte, moins à une intégration des contraintes écologiques qu’à leur disparition au profit de la seule dynamique économique (il est particulièrement significatif que le prix Nobel d’économie ait été attribué, en 2018, à William Nordhaus, pour sa prise en considération du changement climatique, alors qu’il a été l’un des premiers et des plus virulents critiques du rapport Meadows, puis du rapport Stern établissant l’urgence de la lutte contre le changement climatique). La science écologique des contraintes ou des limites n’est pas si aisément soluble dans le capitalisme que Gorz ne semblait le croire.
Dès lors, le rôle et la place de la science dans les politiques écologiques peut faire l’objet d’appréciations opposées, de la part d’écologistes convaincus. Replaçant l’écologie scientifique dans la logique de l’industrialisme et du marché, où la science et la technique sont liés aux pouvoirs de contrôle, Gorz montre comment l’intégration des contraintes écologiques ne peut que se traduire par une extension du pouvoir techno-bureaucratique qui renforce la logique d’hétérorégulation, indifférente aux choix des acteurs sociaux (p. 219). Cela peut conduire à des formes que Gorz qualifiait d’éco-fascistes : incapable de faire face à sa reproduction, le capitalisme accentue sa dictature. Mais on peut aussi, comme l’ont fait Dominique Bourg et Kerry Whiteside (Vers une démocratie écologique, 2010), montrer que les modalités de la démocratie représentative, tout comme le court-termisme de la dynamique économique, ne se prêtent pas à la considération du long terme que requiert le souci écologique. Il faut faire place, dans des institutions spécialement conçues pour cela, à l’expertise scientifique et aux décisions qu’elle inspire. Il ne s’agit plus alors de résister à l’expertocratie, comme le préconisait Gorz, mais de donner à la science un pouvoir que le capitalisme et la démocratie représentative lui dénient. Les deux écologies, alors, ne renvoient pas seulement à des systèmes sociaux différents, mais à deux façons de percevoir les problèmes écologiques.
À ceux qui font valoir l’importance de la crise écologique, Gorz pouvait objecter que la seule prise en compte de l’impératif écologique ne garantissait pas l’issue politique alors que c’est là que les choses se jouent. Quelle place l’écologie politique (au sens de projet social et démocratique) peut-elle faire à l’écologie scientifique? Une société a l’environnement qu’elle mérite. Le productivisme et la recherche du profit ont produit, comme autant de conséquences, la crise écologique. D’une société non productiviste, post-industrielle, dégagée de l’expansion illimitée de la logique marchande, on peut attendre les conséquences inverses : la pression sur la nature ne peut que diminuer. Mais peut-on attendre que les bons effets d’une autre logique sociale se manifestent ? N’y a-t-il pas, dans l’urgence écologique, des mesures à prendre ? Il s’agit, a affirmé à plusieurs reprises Gorz, de « faire plus et mieux avec moins »(cité p. 287) Cette « rationalité écologique » est-elle si différente de la formule classique de la rationalité économique, « faire plus avec moins » ? Sans doute le « mieux », ajouté au « plus » opère-t-il un déplacement du quantitatif au qualitatif, de la quête –irrationnelle pour Gorz- du profit pour le profit, au souci qualitatif des valeurs d’usage, de leur durabilité, d’une orientation vers la qualité et le sens de la vie. Mais le « mieux » ne concerne que la sphère de l’autonomie, celle où l’on vit mieux parce que l’on travaille moins. Le « mieux » caractérise la qualité de la vie sociale, mais nullement celle des rapports techniques à la nature, qui continuent à relever d’une logique instrumentale de l’efficacité. Gorz la caractérise toujours en terme de maîtrise croissante de la nature, de sa domination. La séparation est donc tranchée entre l’extériorité de la nature et l’intériorité du social.
Gorz a toujours réfléchi dans le cadre de la modernité, celui du dualisme de la nature et de la société. C’est ce dualisme que l’on retrouve dans ce que Françoise Gollain présente comme son « schéma binaire », celui de l’hétéronomie et de l’autonomie : il transporte, à l’intérieur de la société, la dualité de la nature et de la société, celle de la nécessité et de la liberté. Dans cette vision dualiste, il ne remet jamais en cause que notre rapport à la nature soit un rapport de maîtrise ou de domination, il ne se demande jamais s’il ne faut pas seulement, en matière technique, faire moins mais aussi faire autrement, envisager d’autres rapports à la nature. Cela le conduit également à ne pas pouvoir penser ce qui se produit dans la zone de contact, ou plutôt d’indifférenciation, entre le social et le naturel. Or sa démarche s’expose d’autant plus à l’objection catastrophiste qu’il pense la menace écologique comme une menace extérieure, distincte des contradictions internes. Il continue à penser la nature et la société, séparément, spatialement, mais aussi temporellement. Dans les années 1990, le passage de l’ère énergétique à l’ère informationnelle lui apparaît comme une rupture technologique : une époque succède à une autre. En fait ces deux « ères » sont contemporaines, et l’informatisation ne fait pas disparaître les questions énergétiques, ne serait-ce que parce que l’informatique est très grosse consommatrice d’énergie. On peut donc mettre en question la prédominance qu’il accorde à « l’immatériel », la possibilité même de croire que quelque chose de tel existe. Son éloge de l’immatériel, et l’idée que le travail matériel doit lui être subordonné, le conduit à négliger la matérialité, au double sens de matérialité sociale (les rapports de production) et de matérialité physique (la consommation d’énergie ou de matériaux rares, non recyclables). Faute de penser à la fois l’intérieur et l’extérieur, la société et la nature, il est conduit à privilégier un côté par rapport à l’autre et s’expose à des critiques justifiées.
Parce qu’il est resté de bout en bout dualiste, Gorz n’a jamais cessé d’être moderne. C’est peut-être sa conviction que l’histoire a un sens qui lui a permis d’apporter une contribution décisive à l’écologie politique, en en faisant un projet social et une volonté démocratique. Mais on peut aussi se demander si, en maintenant le dualisme moderne de la nature et de la société, en séparant l’interne et l’externe, il ne rend pas ce projet à la fois vulnérable à la menace extérieure (peut-on attendre que les conséquences de l’abandon du productivisme relâchent la pression sur la nature ?) et insuffisant : peut-on vraiment espérer être libres dans une nature que l’on continue à dominer ? Mais il faudrait pour cela comprendre, comme l’a dit Bruno Latour, que « nous n’avons jamais été modernes », et que, au lieu de nous penser abstraitement comme humains, il nous faut nous saisir comme « terriens ».
Catherine Larrère est professeure émérite de philosophie à l’Université Paris1 Panthéon-Sorbonne. Elle a co-dirigé l’ouvrage Penser l’anthropocène, Presses de Sciences Po, 2018.