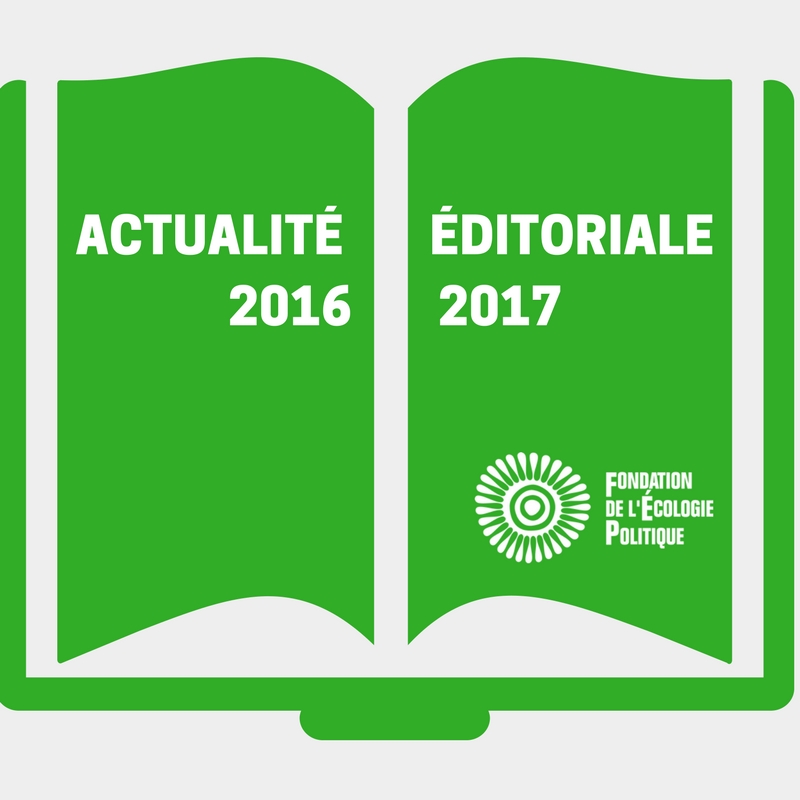Octobre 2016
- Le sacrifice des paysans, une catastrophe sociale et anthropologique, Pierre Bitoun et Yves Dupont, L’Échappée.
- Comment la France a tué ses villes, Olivier Razemon, Rue de l’échiquier.
- Simone Weil ou l’expérience de la nécessité, Gnevième Azam et Françoise Valon, Le passager clandestin.
- Climat, un défi pour la finance, Pierre Ducret et Maria Scolan, Les petits matins.
- Le Bonheur est dans la Scop! Un patrimoine d’expériences pour demain, François Kerfourn, Michel Porta, Les petits matins.
- La solution coopérative, Pierre Liret, Les petits matins.
- Un nouveau droit pour la Terre. Pour en finir avec l’écocide, Valérie Cabanes, Seuil.
- Gentrifications, Marie Chabrol, Anaïs Collet, Matthieu Giroud, Lydie Launay, Max Rousseau, Hovid Ter Minannian, Éditions Amsterdam.
- Élisée, avant les ruisseaux et montagnes, Thomas Giraud, La Contre Allée.
- La démondialisation ou le chaos. Démondialiser, décroître et coopérer, Aurélien Bernier, Utopia.
- La crise environnementale en Chine, Jean-François Huchet, Presses de Sciences Po.
- Les arbres dont je suis fait et autres retours sauvages, Maurice Chaudière, Actes Sud.
- Écologie et environnement. Pour une intelligence mutualisée des savoirs, Marcel B. Bouché, Actes Sud.
- Amazonie. Un jardin naturel ou une forêt domestiquée, Stéphen Rostain, Actes Sud.
- Permaéconomie, Emmanuel Delannoy, Wildproject.
Agriculture et changements globaux. Expertises globales et situations locales, Xavier Arnauld De Sartre, Peter Lang.
- La France résiste-t-elle à l’écologie?, Lucile Schmid, Bord de l’eau.
- Décider de ne pas décider. Pourquoi tant de bloocages?, Michel Claessens, QUAE.
- Nourriture et liberté, Carlo Petrini, José Bové, Serge Latouche, Bernard Farinelli (Collectif), Libres & Solidaires
Novembre 2016
- Adieux au capitalisme. Autonomie, société du bien vivre et multiplicité des mondes, Jérôme Baschet, La Découverte.
- Encyclopédie critique du genre. Corps, sexualité, rapports sociaux, Juliette Rennes, La Découverte.
- Comprendre l’agroécologie, Matthieu Calame, ECLM.
- Écopunk. Les punks, de la cause animale à l’écologie radicale, Fabien Hein et Dom Blake, Le Passager Clandestin.
- Walter Benjamin face à la tempête du progrès, Agnès Sinaï, Le Passager Clandestin.
- Réinventer le progrès. Entretiens avec Philippe Frémeaux, Laurent Berger, Pascal Canfin, Les Petits Matins.
- Et nous vivrons des jours heureux, 100 auteurs, 120 actions pour résister et créer, Collectif, Actes Sud.
- L’empire de la propriété. Les impacts environnementaux du droit de propriété, Eric De Mari, Dominique Taurisson-Mouret, Victoires.
- La communication environnementale, Thierry Libaert, CNRS Éditions.
- Les Suspendu(e)s, Sandrine Roudaut, Éditions La Mer Salée.
- Brouillards Toxics. Vallée de la Meuse, 1930, contre-enquête, Alexis Zimmer, Zones Sensibles.
- Déchets solides ménagers et risques environnementaux au Bénin, Théophane Ayigbédé, L’Harmattan.
- La corruption : un frein au développement durable, Giresse Akono Gantsui, Jets d’Encre.
- Les sols. Intégrer leur multifonctionnalité pour une gestion durable, Antonio Bispo, Camille Guerrier, Edith Martin, Jurgis Sapijanskas, Hélène Soubelet, Claire Chenu, QUAE. g
Décembre 2016
- La vie sans énergie moderne. Pauvre désagréable et brève, Samuele Furfari, L’Harmattan.
- Compétitivité et soutenabilité de la bioéconomie à l’horizon 2050, Mohamed Majdi Chelly, Pierre-Alain Schieb, L’Harmattan.
- Faire du Sahel un pays de Cocagne. Le défi agro-écologique, René Billaz, L’Harmattan.
Agro-énergies dans les territoires. Coopérer pour l’autonomie locale, Geneviève Pierre, Presses Universitaires de Rennes.
Janvier 2017
- Garantir la concertation, Pierre-Yves Guihéneuf, ECLM.
- Passeur, Raphaël Krafft, Buchet Chastel.
- L’accès à l’eau. Enjeu majeur du développement durable, Laurent Baechler, De Boeck.
- Le Gardien du feu, Pierre Rabhi, Albin Michel.
- Le revenu de base. Une idée qui pourrait changer nos vies, Olivier De Naire, Clémentine Lebon, Actes Sud.
- Du jetable au durable. Pour en finir avec l’obsolescence programmée, Laetitia Vasseur, Anne-Sophie Novel, Samuel Sauvage, Gallimard.
- Bulles technologiques, Catherine et Raphaël Larrère, Éditions Wildproject.
- La ville durable interculturelle, Esoh ELAMÉ, L’Harmattan.
- Gestion, maîtrise et aménagement des ressources naturelles en Afrique de l’Ouest et du centre, Lambert Mossoa, L’Harmattan.
- Les métamorphoses de l’écologie. Entre science et expertise, Alexandra Liarsou, L’Harmattan.
La guerre des forêts. Luttes sociales dans l’Angleterre du XVIIIe siècle, Edward Palmer Thompson,La Découverte.
- Les mobilités partagées. Nouveau capitalisme urbain, Maxime Huré, Publications de la Sorbonne.
- Le petit livre du fumain, Joseph Jenkins, Écosociété.
- Les dessous de la politique de l’Oncle Sam, Noam Chomsky (traduit de l’anglais par J.-M. Flémal), Écosociété.
- Désobéir aux grands projets inutiles. Certains élus cherchent à marquer l’histoire à grands coups de travaux inutiles…, Les Désobéissants et Xavier RENOU, Le Passager Clandestin.
- Manifeste animaliste. Politiser la cause animale, Corine Pelluchon, Alma Éditeur.
- Vivons plus vieux en bonne santé ! Des conseils au quotidien pour préserver son capital santé, Sophie Cousin et Véronique Coxam, Éditions Quae.
- Propriété & communs. Idées reçues et propositions, Le Mouvement Utopia, Utopia Éditions.
Février 2017
- Transition énergétique. Une chance pour l’Europe, Claude Turmes, Les Petits Matins.
- Revenu universel. Pourquoi? Comment? Julien Dourgnon, Les Petits Matins et l’Institut Veblen.
- Le choix du pire, de la planète aux urnes, Corinne Lepage, Dominique Bourg, PUF.
- Ce qui compte vraiment, Fabrice Nicolino, LLL.
- Que faire des restes? Le réemploi dans les sociétés d’accumulation, Nathalie Benelli, Delphine Corteel, Octave Debrary, Bénédicte Florin, Stéphane Le Lay, Sophie Réfif, Presses de Sciences Po.
- Plaidoyer pour nos agriculteurs. Il faudra demain nourrir le monde…, Sylvie Brunel, Buchet Chastel.
- Confessions d’un entrepreneur pas comme les autres, Yves Chouinard, Vuibert.
- Ruralité, nature et environnement. Entre savoirs et imaginaires, Philippe Hamman, Eres.
- Humanités environnementales. Enquêtes et contre-enquêtes, Guillaume Blanc, Élise Demeulenaere, Wolf Feuerhahn, Publications de la Sorbonne.
- Agriculture et alimentation durables. Trois enjeux dans la filière céréales, Gilles Charmet, Joël Abécassis, Sylvie Bonny, Anthony Fardet, Florence Forget, Valérie Lullien-Pellerin, QUAE.
- Économie circulaire et Territoire, Yvette Lazzeri, Dominique Bonet Fernandez & Mariane Domeizel, Presses Universitaires de Provence
- Le travail, et après?, Rodolphe Christin, Jean-Christophe Giuliani, Philippe Godard, Bernard Legros, Écosociété.
- Les catastrophes naturelles au Moyen Âge,Thomas Labbé, CNRS Éditions.
- Le Mythe moderne du progrès, Jacques Bouveresse, Agone.
- Paysans mutins, paysans demain. Pour une autre politique, Gérard Choplin, Éditions Yves Michel.
Mars 2017
- Aux origines de la décroissance, Cinquante penseurs, coordonné par Cédric Biagini, David Murray et Pierre Thiesset, L’Échappée.
- Alexandre Chayanov pour un socialisme paysan, Renaud Garcia, Le Passager Clandestin.
- Bien vivre. Autonomie, dignité, solidarités, Collectif, Les Petits Matins.
- Pour une économie citoyenne. L’économie sociale et solidaire face au défi numérique, Sébastien Darrigrand, Hugues Vidor, Les Petits Matins.
- ‘Marxismes écologiques’, Actuel Marx 2017 – n°61, Sous la direction de Pierre Charbonnier, Stéphane Haber, Razmig Keucheyan, PUF.
- Changer d’avenir. Réinventer le travail et le modèle économique, Les économistes atterrés, LLL.
- Le climat dans tous ses états !, Pierre Martin, De Boeck.
- Manifeste pour une agriculture durable, Lydia et Claude Bourguignon, Actes Sud.
- Vers l’agroécologie, paroles de paysans, Collectif, Actes Sud.
- Transformations agricoles et agroalimentaires. Entre écologie et capitalisme, Gilles Allaire, Benoît Daviron, Quae.
- La société écologique et ses ennemis, Serge Audier, La Découverte
- Vivre avec les catastrophes, Yoann Moreau, PUF
- Biodiversité, quand les poltiques européennes menacent le vivant. Connaître la nature pour mieux légiférer, Inès Trépant, Yves Michel Éditions.
- Des territoires vivants pour transformer le monde, Patrick Caron, Elodie Valette, Tom Wassenaar ,Geo Coppens d’Eeckenbrugge, Quae.
- 2050 : quelles énergies pour nos enfants? Pierre Papon, Éditions Le Pommier
- Écologie intégrale, Michel Godron, L’Harmattan
- Après le capitalisme, Pierre Madelin, Écosociété.
- La naissance de l’écologie politique en France. Une nébuleuse au coeur des années 68, Alexis Vrignon, Presses Universitaires de Rennes.
- Carbon Democracy. Le pouvoir politique à l’ère du pétrole, Timothy Mitchell, La Découverte.
- Environnement et développement durable dans les politiques de l’Union européenne, Gérard Brovelli, Mary Sancy, Presses Universitaires de Rennes.
- La Chine au risque de la dépendance alimentaire, Jean-Marc Chaumet et Thierry Pouch, Presses Universitaires de Rennes.
- Éthique de la nature ordinaire. Recherches philosophiques dans les champs, les friches et les jardins, Rémi Beau, Publications de la Sorbonne.
- Construire des politiques alimentaires urbaines. Concepts et démarches, Julie Debru, Benoit Daviron, Christophe-Toussaint Soulard, Caroline Brand, Nicolas Bricas, Laura Michel, QUAE.
Les rivières urbaines et leurs pollutions, Laurence Lestel, Catherine Carré, QUAE.
- Refonder l’espace public, Antoine Gitton, Libre & Solidaire.
- Entropia. La vie au-delà de la civilisation industrielle, Samuel Alexander, Libres & Solidaires.
- À nous la ville! Traité de municipalisme, Jonathan Durand, Écosociété.
- Notre bonne fortune. Repenser la prospérité, Éloi Laurent, PUF.
- La réalisation de soi. Spinoza, le bouddhisme et l’écologie profonde, Arne Næss, Wildproject.
- Soeurs en écologie. Des femmes, de la nature et du réenchantement du monde, Pascale Erm, Éditions La Mer Salée.
- Nous n’irons plus pointer chez Gaïa. Jours de travail chez Kokopelli, Le Grimm, Éditions Du bout de la ville.
- Santé et environnement. Expertise et régulation des risques, Béatrice Parance, CNRS Éditions.
- La France des solutions. Ces citoyens qui bâtissent l’avenir, Collectif et Jean-Louis Étienne, Éditions Arthaud.
- Manger est un acte citoyen, Alain Ducasse, Christian Regouby, Éditions Les Liens qui Libèrent.
- Encore carnivores demain ? Quand manger de la viance pose question au quotidien, Olivier Néron de Surgy et Jocelyne Porcher, Éditions Quae.
- La vie secrète des arbres, Peter Wohlleben, Les Arènes.g
Avril 2017
La bio pour tous. Transition agricole et alimentaire : c’était mieux… demain !, Red! et Stéphen Kerckhove, Le Passager Clandestin.
Comment nous pourrions vivre, Une conférence de l’un des tout premiers écolos radicaux !, William Morris, Le Passager Clandestin.
Biocontôle en protection des cultures, Périmètre, succès, freins, espoirs, Coordonné par Jean-Louis Bernard, L’Harmattan.
- Les déchets, ça suffit. L’État des lieux, Jacques Exbalin, l’Harmattan.
Le changement climatique va-t-il tout changer ? Manifeste pour une République sociale, écologique et conviviale, Arno MÜNSTER, L’Harmattan.
- Fiscalité carbone et finance climat. Un contrat social pour notre temps, Emmanuel Combet, Jean-Charles Hourcade, L’Harmattan.
- Manifeste pour une véritable économie collaborative. Vers une société des communs, ECLM, Michel Bauwens, Vasilis Kostakis.
- Habitat durable. L’évidence de la construction passive, Jean-Loup Bertez, Jean-Claude Tremsal, Alternatives Éditions.
- La Chine face au mur de l’environnement ?, Jean-Paul Maréchal, CNRS Éditions.
- Le soucis de la nature. Apprendre, inventer, gouverner, Cynthia Fleury, Anne-Caroline Prévot, CNRS Éditions.
- L’anthropocène contre l’histoire. Le réchauffement climatique à l’ère du capital, Andreas Malm, Éditions La Fabrique.
- Prédateurs et résistants. Appropriation et réappropriation de la terre et des ressources naturelles (16ème-20ème siècles), Pablo F. Luna et Niccolo Mignemi, Éditions Syllepse.
- Penser l’éventuel. Faire entrer les craintes dans le travial scientifique, Nicolas Bouleau, Éditions Quae
- La dépendance alimentaire de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, Chantal Le Mouël, Bertrand Schmitt, Éditions Quae
Mai 2017
- Homo detritus. Critique de la société du déchet, Baptiste Monsaingeon, Seuil.
- Biomimétisme. Quand la nature inspire des innovations durables, Janine M. Benyus, Rue de l’échiquier.
- Le Pouvoir de la pédale. Comment le vélo transforme nos sociétés cabossées, Olivier Razemon, Rue de l’échiquier.
- Gouverner la décroissance. Politiques de l’anthropocène III, sous la direction d’Agnès Sinaï et Mathilde Szuba, Presses de Sciences Po.
Le sourire de Prométhée, L’homme et la nature au Moyen Âge, Fabrice Mouthon, La Découverte.
- Histoire d’un ruisseau, suivi de Histoire d’une montagne, Élisée Reclus, Éditions Arthaud.
- Une éthique pour la nature, Hans Jonas, Éditions Arthaud.
- L’âge de l’anesthésie. La mise sous contrôle des affects, Laurent De Sutter, Éditions Les Liens Qui Libèrent.
- Les sols et la vie souterraine. Des enjeux majeurs en agroécologie, Jean-François Briat et Dominique Job, Éditions Quae.
Juin 2017
L’économie écologique, Ali Douai, Gaël Plumecocq, La Découverte
- Et si on mangeait local ? Ce que les circuits courts vont changer dans mon quotidien, Patrick Philipon, Yuna Chiffoleau, Frédéric Wallet, Éditions Quae.
- Les dessous de l’alimentation bio, Claude Gruffat, Éditions La Mer Salée
- L’homme peut-il accepter ses limites ?, Gilles Boeuf, Bernard Swynghedauw, Jean-François Toussaint, Éditions Quae.
Juillet 2017
- Décroissance, ici et maintenant !, Fabrice Flipo, Le passager Clandestin
- La biodiversité : avec ou sans l’homme?, Christian Lévêque, Éditions Quae.
Août 2017
- La vigne et le vin en France, de l’Antiquité au XXème siècle, Pierre Salles, Éditions Libre et Solidaire.
- Utopies réelles, Erik Olin Wright, Éditions La Découverte.
Le champignon de la fin du monde. Sur les possibilités de vie dans les ruines du capitalisme, Anna Lowenhaupt Tsing, Éditions La Découverte.
- Le monde qui émerge. Les alternatives qui peuvent tout changer, ATTAC, Éditions LLL.
Septembre 2017
- L’Occident, malade de sa médecine. Pollutions, coûts, effets indésirables…, Christian Portal, Éditions Libre et Solidaire.
Octobre 2017
- Critique de l’habitabilité, Mathias Rollot, Éditions Libre et Solidaire.
- Après le monde plat. Apocalypse ou renouveau ?, Éditions Libre et Solidaire.
Octobre 2016
 Le sacrifice des paysans, une catastrophe sociale et anthropologique
Le sacrifice des paysans, une catastrophe sociale et anthropologique
Pierre BITOUN et Yves DUPONT
L’Échappée, 336 pages, 19 euros
Pourquoi les sociétés modernes ont-elles décidé de sacrifier les paysans ? Qui est responsable de ce processus qui semble irréversible ? Pour tenter de répondre à ces questions fondamentales, ce livre montre comment, depuis des décennies, en France comme ailleurs, le productivisme s’est étendu à l’ensemble des activités humaines. Avec pour conséquences : déracinement et marchandisation, exploitation du travail et des ressources naturelles, artificialisation et numérisation de la vie. L’époque est aujourd’hui aux fermes-usines et aux usines que l’on ferme ou délocalise, tandis que dominent, partout, finance et technoscience.
Le sacrifice des paysans est l’un des éléments du processus global de transformation sociale dont il faut, au préalable, comprendre les causes. Ainsi, les auteurs analysent le mouvement historique au sein duquel s’est déployé le projet productiviste au cours des 70 dernières années, des « Trente Glorieuses aux Quarante Honteuses ». Puis ils expliquent comment le long travail d’« ensauvagement des paysans » a mené à la destruction des sociétés paysannes et des cultures rurales.
De ce véritable ethnocide, qui a empêché l’alternative au capitalisme dont une partie des paysans était porteuse, nous n’avons pas fini, tous, de payer le prix.
Comment la France a tué ses villes
Olivier RAZEMON
Rue de l’Échiquier, 208 pages, 18 €
Des vitrines vides et sombres, des façades aveugles, des stores métalliques baissés. Calais, Agen, Le Havre, Landerneau, Avignon, Lunéville… la crise urbaine ronge les préfectures et sous-préfectures, les détruit de l’intérieur. Les boutiques abandonnées ne constituent que le symptôme le plus flagrant d’un phénomène plus large : la population stagne, les logements sont vacants, le niveau de vie baisse. Alors que se passe-t-il ?
L’offensive délibérée de la grande distribution, en périphérie, tue les commerces du centre-ville et des quartiers anciens, et sacrifie les emplois de proximité. Mais les modes de vie sont fortement liés aux modes de déplacement. Ainsi, au-delà de la dévitalisation urbaine, cet ouvrage observe les conséquences, sur le territoire, de la manière dont on se déplace. Partout, la voiture individuelle reste considérée comme une obligation, un dû. Or, parce qu’elle occupe de l’espace et génère bruit et pollution, la motorisation contribue largement à l’asphyxie des villes.
Comment la France peut-elle sauver ses villes ? Il n’existe nulle solution miraculeuse, mais une série de petits pas, de décisions empreintes de sobriété.
 Simone Weil ou l’expérience de la nécessité
Simone Weil ou l’expérience de la nécessité
Geneviève AZAM, Françoise VALON
Le Passager Clandestin, 100 pages, 8 €
Simone Weil (1909-1943) fut une lanceuse d’alerte dont la voix fut recouverte en son temps. Ce qu’elle annonçait se vérifie aujourd’hui : le système capitaliste et industriel tend à détruire toutes les bases possibles d’une organisation différente, et il subsistera jusqu’à l’extrême limite de ses possibilités. Son appel à une dissidence ultime qui renouerait le « rapport originel de l’esprit avec le monde » doit donc plus que jamais être entendu.
Simone Weil a tenté de concevoir un projet de civilisation capable d’accueillir les tensions entre exigence de liberté et confrontation avec les limites matérielles du monde – la « nécessité ». Ce projet exige un renversement des valeurs instituées dans des sociétés vouées au « règne de la force ». Il annonce celui de la décroissance par son exigence d’une pensée lucide, le refus de la force et de la vitesse, la coopération, la décentralisation, l’amitié et le sens de la beauté.
Les auteurs réunis dans cette collection constituent les racines de la pensée politique de la décroissance. L’apport de Simone Weil à cette pensée est présenté ici par Geneviève Azam et Françoise Valon ; la seconde partie de l’ouvrage est composée d’extraits qui offrent un accès direct à son œuvre.
Climat, un défi pour la finance
Pierre DUCRET, Maria SCOLAN
Les Petits Matins, 256 pages, 20 €
Après la COP 21, la finance est au coeur des négociations sur le climat. Maintenir le réchauffement en deçà de 2 °C nécessite en effet une réorientation massive des investissements : il faut cesser de financer les secteurs fortement émetteurs de carbone, privilégier les activités « vertes » et soutenir de nouveaux modèles économiques. Mais le secteur est-il prêt à opérer cette mutation ?
Cet ouvrage est animé par la conviction que la finance a tous les moyens d’apporter une contribution essentielle à la transition de l’économie mondiale vers un modèle neutre en carbone. Il fait le récit de la prise de conscience récente de l’enjeu climatique par l’univers de la finance, il décrit et explique les leviers dont dispose le secteur et il trace les perspectives de la généralisation de la « finance climat ».
Car la transformation est engagée : il faut maintenant l’accélérer. Aujourd’hui, les risques à ne pas agir et les opportunités à saisir doivent être un moteur pour l’ensemble de l’industrie financière.
 Le bonheur est dans la Scop! Un patrimoine d’expériences pour demain
Le bonheur est dans la Scop! Un patrimoine d’expériences pour demain
François KERFOURN, Michel PORTA
Les Petits Matins, 368 pages, 20 €.
Il existe des alternatives au management traditionnel. C’est ce dont témoignent ici des hommes et des femmes de plusieurs générations, issus d’une trentaine de sociétés coopératives et participatives (Scop).
À travers ces récits, c’est un modèle atypique d’entreprise qui apparaît, alliant éthique professionnelle et bonheur au travail. Dans ces structures où la répartition de la richesse produite se fait avec davantage de transparence et d’équité, les salariés ne sont plus de simples exécutants mais de véritables co-entrepreneurs. Informés de la marche de l’entreprise, ils participent à l’adoption de ses grandes orientations et élisent leur dirigeant. Ils perçoivent une part importante du bénéfice tout en respectant la priorité donnée aux investissements de développement et à la pérennité des emplois.
À la rencontre de ces innovations entrepreneuriales, et sans occulter les difficultés à surmonter, les auteurs font découvrir l’étonnante diversité selon les métiers, la taille des entreprises, les régions et, bien sûr, les personnalités. Surtout, ils mettent en avant des clés de succès qui méritent d’être mieux connues.
Pierre LIRET
Les Petits Matins, 640 pages, 25 €
Alsace Lait, la Scop Artenréel, mais aussi les magasins Leclerc, le Crédit mutuel et bien d’autres comptent parmi ces sociétés qu’on appelle « coopératives » et qui jalonnent le territoire français. Présentes dans tous les secteurs d’activité, elles sont particulièrement puissantes dans l’agriculture, la banque et le commerce. Leur taille parfois gigantesque ne leur permet pas toujours d’entretenir un lien de proximité avec leurs membres adhérents, mais elles présentent l’atout essentiel d’être indépendantes d’actionnaires financiers.
Quelles sont les spécificités de ces entreprises ? À l’ère de la domination des multinationales, les coopératives constituent-elles une véritable alternative ou bien sont-elles condamnées à choisir entre rester à la marge ou se banaliser ? Quelle importance accorder à ce système économique ultra-territorialisé que propose le modèle coopératif ?
En combinant réflexion d’ensemble et enquête de terrain, ce livre permet de mieux connaître les coopératives qui ont la particularité d’être les seules formes d’organisation disposant de principes de fonctionnement extra-économique à l’échelle mondiale. Tout en identifiant ses limites, il montre les atouts du modèle coopératif et les solutions qu’il apporte : en maintenant l’activité économique et sociale à l’échelle locale, il constitue un garde-fou contre la volatilité des capitaux et des emplois, permettant de concilier projet professionnel et projet de vie.
 Un nouveau droit pour la terre. Pour en finir avec l’écocide
Un nouveau droit pour la terre. Pour en finir avec l’écocide
Valérie CABANES
Seuil, 368 pages, 20 €
Peuples et sociétés sont dépossédés de leurs moyens d’existence à travers le monde par la destruction de leur environnement. Face à cet écocide, comment repenser les droits de l’homme ?
L’écocide (fait de détruire la « maison Terre ») n’est pas un crime de plus, s’ajoutant à toutes les autres atteintes aux droits humains. Il est désormais le crime premier, celui qui ruine les conditions mêmes d’habitabilité de la Terre. D’ores et déjà, les dérèglements en cours attisent injustices et tensions géopolitiques tandis que les saccageurs de la planète restent impunis. Aussi est-il urgent de revendiquer de nouvelles formes de responsabilité et de solidarité. Urgent de redéfinir un nouveau sens et de nouveaux cadres à l’action humaine au sein des limites planétaires. Le droit international doit se métamorphoser et s’universaliser autour d’une nouvelle valeur pivot, l’écosystème Terre, en reconnaissant un cinquième crime international, le « crime d’écocide ».
Valérie Cabanes est juriste en droit international, spécialisée dans les droits de l’homme. Après deux décennies dans des ONG de terrain sur les droits de l’homme, elle est porte-parole du mouvement End Ecocide on Earth. En 2015, elle a contribué à la rédaction du projet de Déclaration universelle des droits de l’humanité remis à François Hollande ainsi qu’à deux ouvrages collectifs, Crime climatique, stop ! (Seuil, 2015), Des droits pour la Nature (Utopia, 2016).
« Le livre de Valérie Cabanes est un livre de combat. Un combat juridique et existentiel, à la fois au long cours et face à l’urgence. »
Extrait de la préface de Dominique Bourg
Marie CHABROL, Anaïs COLLET, Matthieu GIROUD, Lydie LAUNAY, Max ROUSSEAU, Hovig TER MINASSIAN
Éditions Amsterdam, 360 pages, 21 €
Hipsters, bobos, yuppies, gentrifieurs… Les termes ne manquent pas pour qualifier les nouvelles populations qui s’approprient les quartiers centraux anciens de certaines métropoles au détriment des habitants populaires. Mais cette profusion empêche de comprendre le phénomène : comment dépasser les oppositions binaires entre gentrifieurs et gentrifiés ? Quels sont les moteurs, les logiques et les enjeux de la gentrification ? Est-elle vraiment inéluctable ?
Ancrée dans des contextes précis – historiques et géographiques, économiques et politiques –, elle s’incarne dans des bâtiments, des commerces, des groupes sociaux, des pratiques et des esthétiques propres aux lieux dans lesquels elle se déroule. Pour cette raison, elle est irréductible à une mécanique simple et identique d’une ville à l’autre, d’un quartier à l’autre. À travers l’exploration de la diversité des formes, des lieux et des acteurs de la gentrification dans une dizaine de villes européennes (parmi lesquelles Paris, Montreuil, Lyon, Grenoble, Roubaix, Barcelone, Lisbonne, Sheffield) cet ouvrage se propose donc de définir l’« ADN » de la gentrification : un rapport social d’appropriation de l’espace urbain, mettant aux prises des acteurs et des groupes inégalement dotés.
 Élisée. Avant les ruisseaux et les montagnes
Élisée. Avant les ruisseaux et les montagnes
Thomas GIRAUD
La Contre Allée, 136 pages, 14 €
En imaginant ce qu’ont pu être certains épisodes de la vie d’Elisée Reclus (1830-1905), avant qu’il ne devienne l’auteur d’Histoire d’un ruisseau et Histoire d’une montagne, ce premier roman nous met dans les pas d’un personnage atypique et toujours d’une étonnante modernité.
La démondialisation ou le chaos. Démondialiser, décroître et coopérer
Aurélien BERNIER
Éditions Utopia, 160 pages, 10 €
Comment ne pas voir que toutes les « crises » économiques, environnementales et démocratiques, ainsi que les dérives identitaires – du terrorisme à l’extrême droite –, ne sont que le résultat d’un seul et même processus : celui de la mondialisation et de la financiarisation de l’économie, provoquant un désastre économique, social, culturel et verrouillant l’ordre international ?
Partout dans le monde, les luttes sociales se heurtent au libre échange, au chantage à la délocalisation et à la fuite des capitaux. En l’absence de perspective de sortie « par la gauche » de cet engrenage, les nombreuses victimes de cette mondialisation se résignent ou choisissent la stratégie du pire.
Pour ne pas sombrer petit à petit dans le chaos et redonner de l’espoir, sans pour autant défendre un capitalisme national, il faut mettre en oeuvre un projet de rupture qui repose sur trois piliers : la démondialisation pour rompre avec le capitalisme, la décroissance pour répondre aux crises environnementales et la coopération internationale pour renouer avec l’idée de justice sociale au sens le plus global.
Ce livre contribue à engager une nouvelle bataille des idées pour lutter contre l’extrême droite et le terrorisme, mais aussi pour combattre le fatalisme qui conduit à la soumission, à l’abstention et au désengagement.
Il vise également à dépasser le débat opposant à gauche nation et internationalisme.
 La crise environnementale en Chine. Évolutions et limites des politiques publiques.
La crise environnementale en Chine. Évolutions et limites des politiques publiques.
Jean-François HUCHET
Presses de Sciences Po, 152 pages, 15 €
En Chine, tous les clignotants sont au rouge en matière d’environnement.
Il est encore difficile d’évaluer les conséquences humaines et économiques de la pollution de l’air, de l’eau et des sols, de l’érosion et de la désertification, des pluies acides, de la gestion des déchets, mais les chiffres officiels font état d’un coût annuel de 5,8 % à 8 % du PIB national. Les autorités chinoises ont tardivement pris acte de la gravité de la crise, dont cet ouvrage dresse le bilan. Il a fallu les épisodes d’« airpocalypse » à Pékin de l’hiver 2013 pour qu’elles se décident à renforcer et à faire appliquer une législation environnementale ambitieuse, mise en place au début des années 2000 mais largement ignorée par les industriels. Quant aux effets de ce changement de politiques publiques, ils ne se feront sentir qu’à long terme, car les principales causes structurelles de la dégradation de l’environnement en Chine – la démographie, l’urbanisation, la dépendance à l’égard des énergies fossiles – n’évolueront pas favorablement avant des décennies.
Une situation précaire qui engage l’avenir de la Terre à double titre : non seulement parce que la Chine est le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre et consomme à elle seule plus de charbon que tous les autres pays réunis. Mais aussi parce qu’elle va devenir le plus grand laboratoire et investisseur mondial dans les énergies vertes.
Les arbres dont je suis fait et autres retours sauvages.
Maurice CHAUDIÈRE
Actes Sud, 272 pages, 20€
Ainsi commence Les Arbres dont je suis fait et autres retours sauvages, opuscule où Maurice Chaudière invite le lecteur à opérer le changement de société qu’il appelle de ses voeux pour aller à l’encontre d’une évolution de l’espèce humaine qu’il qualifie de suicidaire. Comment ? En retrouvant le sens primitif de notre existence, en regagnant en autonomie et en créativité, en se réappropriant des savoirs oubliés, en se tournant vers la nature pour réapprendre à vivre en harmonie avec elle.
Maurice Chaudière a connu plusieurs territoires, plusieurs vies qui ont fait de lui, à plus de quatre-vingt-sept ans, le pédagogue, sculpteur, potier, apiculteur, greffeur et conteur de renom qu’il est aujourd’hui. Il a grandi dans une petite ferme en polyculture, où, dès son enfance, il a vécu au rythme des saisons, observant les plantes et les animaux de son environnement : figuiers, plaqueminiers, amandiers, grenadiers, pigeons, tourterelles, abeilles, congres… Chez lui, on a toujours cueilli et chassé le sauvage, on se nourrit de ce que l’on produit. Dès ses premiers pas, il a découvert la greffe, grandi parmi les animaux de la basse-cour, s’est initié à l’apiculture et aux fondements de l’élevage. Il en garde des savoir-faire précieux, un sens de l’observation aigu et l’art de faire du bon et du beau à partir de ce qu’il a autour de lui !
 Écologie et environnement. Pour une intelligence mutualisée des savoirs.
Écologie et environnement. Pour une intelligence mutualisée des savoirs.
Marchel B. BOUCHÉ
Actes Sud, 160 pages, 18 €
Alors que la société civile attend des connaissances accessibles dans le domaine de l’environnement, pour pouvoir évaluer ses actes vis-à-vis de celui-ci, le morcellement des savoirs scientifiques est tel qu’il rend inintelligibles les résultats obtenus par chaque spécialiste. Se basant sur sa propre expérience de chercheur, Marcel B. Bouché propose une méthode pour mutualiser enfin les connaissances de tous, pour tous.
En effet, au cours de ses recherches, cinquante ans durant, l’auteur a donné la primauté aux observations concrètes de nos écosystèmes (champs cultivés, forêts, prairies…). Il a peu à peu dégagé la “démarche scientifique fondamentale”, rendue possible à la suite de la découverte du rôle-pivot des “données initiales concrètes” (DICS) qu’il a caractérisées. Ces DICS, seules perceptions que nous ayons du réel, sont faciles à gérer en informatique et constituent le support de toutes les interprétations critiquables exprimées en des termes précisables. À condition de s’écarter de la doxa technoscientifique dominante actuelle, les connaissances peuvent alors être partagées en une “intelligence mutualisée et informatisée des savoirs”.
Cette démarche marque la fin de l’incommunicabilité entre science et société, entre spécialistes et citoyens. Cette ouverture nous responsabilise tous vis-à-vis de notre environnement. Elle amène à reconnaître les devoirs humains vis-à-vis de l’environnement auquel nous appartenons – des règles qui permettront un avenir épanoui. En ayant accès à tous les savoirs sérieux relatifs à nos milieux et à nos actes dans ceux-ci, nous pouvons dès lors fonder notre développement sur des observations directes et des interprétations critiquables, en respectant notre cadre de vie.
Amazonie. Un jardin naturel, ou une forêt domestiquée.
Stephen ROSTAIN
Actes Sud, 280 pages, 28 €
L’Amazonie fascine, tant par ses dimensions gigantesques que sa supposée nature indomptée. Pourtant, c’est bien plus l’impact millénaire de l’homme sur cette forêt qui émerveille. Il a en effet notamment transformé le couvert végétal en favorisant des associations de plantes, créé des sols fertiles appelés terra preta et construit des terrassements qui ont modifié le modelé de la superficie.
C’est une vision totalement renouvelée de l’interaction ancienne homme-milieu dans la plus grande forêt tropicale du monde qu’offre l’auteur, chercheur qui travaille depuis 30 ans en Amazonie, en convoquant des disciplines aussi diverses que l’archéologie, l’ethnohistoire, l’anthropologie, l’écologie, la botanique ou la pédologie.
Emmanuel DELANNOY
Wildproject, 160 pages, 12 €
Encore masquée par le fracas du vieux monde, une révolution économique est en cours. Fondée sur une nouvelle relation au vivant, inspirée de la permaculture, la permaéconomie entretient la richesse de la biosphère, ce socle fondamental de toute prospérité.Or dans son fonctionnement actuel, notre économie ne semble plus capable de créer la prospérité partagée qu’on est en droit d’attendre d’elle. La confiance n’y est plus. À qui la faute ? S’il y a bien sûr les excès d’un capitalisme ‘hors sol’, financiarisé à outrance, il y a aussi la majorité silencieuse qui laisse faire, dépassée par un système dont les rouages lui échappent. Chercher à comprendre, c’est déjà désobéir. Entreprendre autrement, produire autrement, consommer autrement, c’est déjà résister. De nouveaux modèles révolutionnaires sont déjà à l’oeuvre : économie circulaire, économie de la fonctionnalité, biomimétisme… La permaéconomie est le nouveau paradigme qui permet de les mettre en cohérence. Emmanuel Delannoy en présente ici les principes et ses premières réalisations, pour les citoyens, les entrepreneurs, et les décideurs.
Agriculture et changements globaux. Expertises globales et situations locales
Xavier Arnauld DE SARTRE
Peter Lang, 204 pages, 39 €
L’agriculture est au cœur des changements globaux, tant pour avoir participé à leur survenue que comme solution potentielle. Aussi n’est-il pas étonnant qu’elle tienne une place particulière dans les prospectives destinées à faire réfléchir les décideurs sur les scénarios souhaitables pour relever les défis posés par ces problématiques. Deux scénarios, considérés comme des scénarios de rupture, retiennent particulièrement l’attention des analystes : le scénario dit de Technogarden, destiné à utiliser les technologies pour résoudre les problèmes posés par le mode de développement moderne, et le scénario dit Mosaïque adaptative qui prône l’autonomie des territoires, voire une certaine décroissance.
Après avoir examiné dans la première partie de l’ouvrage les fondements scientifiques de ces analyses, les enjeux des prospectives et les différentes options qu’elles posent, la deuxième partie est consacrée à l’analyse de trois situations concrètes : la protection de la forêt tropicale en Afrique centrale, la colonisation de l’Amazonie et la production au travers de semences transgéniques dans les Pampas argentines.
Écrit par un géographe mais faisant largement appel aux apports des sciences sociales, cet ouvrage montre l’importance des verrouillages spatiaux, c’est-à-dire des rapports à l’espace hérités des cinquante dernières années et limitant fortement les possibilités d’innovations.
 La France résiste-t-elle à l’écologie?
La France résiste-t-elle à l’écologie?
Lucile SCHMID
Bord de l’eau, 146 pages, 14 €
Les signes d’un sentiment écologiste se multiplient dans la société française. Pour autant, les résistances au cœur du pouvoir, des élites politiques et économiques, et parfois scientifiques, sont palpables. L’écologie remet en cause une manière de penser « à la française » : une égalité dont la mise en œuvre repose sur la centralisation, un État qui assume des missions confiées ailleurs aux entreprises, une proximité des grands groupes économiques, des administrations et des experts, une foi parfois déraisonnable dans le progrès technique, et des réflexions sur la nature et les questions environnementales qui s’élaborent indépendamment de la culture politique. Les résistances existent aussi chez les Français eux-mêmes. Car l’écologie est aussi affaire de choix quotidiens : consommer autrement, retrouver des savoir-faire oubliés, imaginer de pouvoir vivre avec le souci du monde, de la planète et de l’avenir lointain. Et surtout elle repousse toujours plus nos frontières, culturelles, géographiques, politiques.
Avec l’écologie, l’ingénierie et le mécano technocratiques ne fonctionnent pas. Lucile Schmid nous invite à renouer avec l’innovation économique et avec le courage politique, et rappelle que démocratie et écologie doivent plus que jamais se penser ensemble. L’écologie n’est ni punitive, ni positive, ni sectaire. Elle dépend de ceux qui la font, la pensent et la pratiquent.
L’enjeu est de taille : refonder l’universalisme français sur l’écologie.
Décider de ne pas décider. Pourquoi tant de blocages?
Michel CLAESSENS
QUAE, 132 pages, 16 €
Plusieurs types de non-décisions sont présentés dans ce petit ouvrage. Certaines non-décisions ne sont qu’une forme particulière (et souvent particulièrement triviale) de décision. D’autres obéissent au contraire à des mécanismes spécifiques dans lesquels les nouvelles technologies mondialisées jouent un rôle essentiel et assurent leur déploiement à tous les niveaux de la société.
Carlo PETRINI, José BOVÉ, Serge LATOUCHE, Bernard FARINELLI, Jacques BOUTAULT, Charlotte SALAT, Linda BEDOUET, Bastien BEAUFORT, Philippe MAFFRE, Pierre LECOUTRE
Libres & Solidaires, 125 pages, 17 €
Ce livre est issu d’une rencontre-débat entre les auteurs et le public autour d’idées phares : proposer des actions pour nous libérer des contraintes que nous impose l’économie de marché, reprendre en main notre manière de nous nourrir et permettre aux pays défavorisés d’être autonomes sur le plan alimentaire.
Des questions essentielles sont abordées pour :
– Se libérer du fléau de la faim et de la honte de la malnutrition.
– Se libérer de l’agriculture industrielle et retrouver une agriculture saine.
– Se libérer des circuits de distribution, privilégier les circuits courts.
– Se libérer de la « bouffe » industrielle, des fast-foods et des plats préparés.
Retrouver le plaisir du goût et des produits locaux.
La nourriture sera le combat majeur dans les prochaines décennies, non seulement pour nourrir la population, mais aussi pour conserver les modes de production liés aux spécificités de chaque région. Agissons pour que nos aliments soient, selon la formule de Carlo Petrini, bons, propres et justes.
Novembre 2016
Adieux au capitalisme. Autonomie, société du bien vivre et multiplicité du monde.
Jérôme BASCHET
La Découverte, 208 pages, 8,50 €
Il est temps de rouvrir le futur. Et d’engager résolument la réflexion sur ce que peut être un monde libéré de la tyrannie capitaliste. C’est ce que propose ce livre, en prenant notamment appui sur les expérimentations sociales et politiques accumulées par l’insurrection et les communautés zapatistes, une « utopie réelle » de grande envergure.
Pratiquer une démocratie radicale d’autogouvernement et concevoir un mode de construction du commun libéré de la forme État ; démanteler la logique destructrice de l’expansion de la valeur et soumettre les activités productives à des choix de vie qualitatifs et collectivement assumés ; laisser libre cours au temps disponible, à la dé-spécialisation des activités et au foisonnement créatif des subjectivités ; admettre une pluralité des chemins de l’émancipation et créer les conditions d’un véritable échange interculturel : telles sont quelques-unes des pistes qui dessinent les contours d’un anticapitalisme non étatique, non productiviste et non eurocentrique.
En conjuguant un effort rare de projection théorique avec une connaissance directe de l’une des expériences d’autonomie les plus originales des dernières décennies, Jérôme Baschet s’écarte des vieilles recettes révolutionnaires dont les expériences du XXe siècle ont montré l’échec tragique. Il propose d’autres voies précises d’élaboration pratique d’une nouvelle manière de vivre.
Encyclopédie critique du genre. Corps, sexualité, rapports sociaux.
Juliette RENNES
La Découverte, 752 pages, 35 €
« Désir(s) », « Mondialisation », « Nudité », « Race », « Voix »… Les soixante-six textes thématiques de cette encyclopédie explorent les reconfigurations en cours des études de genre.
Trois axes transversaux organisent cette enquête collective : le corps, la sexualité, les rapports sociaux. Dans les activités familiales, sportives, professionnelles, artistiques ou religieuses, les usages du corps constituent désormais un terrain privilégié pour appréhender les normes et les rapports de genre. Les pratiques érotiques que les sociétés, à travers l’histoire, ont catégorisées comme normales ou déviantes occupent quant à elles une place inédite pour éclairer les articulations entre hiérarchies des sexes et des sexualités. Enfin, les inégalités liées au genre sont de plus en plus envisagées en relation avec celles liées à la classe sociale, la couleur de peau, l’apparence physique, la santé ou encore l’âge. Cette approche multidimensionnelle des rapports sociaux a transformé radicalement les manières de penser la domination au sein des recherches sur le genre.
En analysant les concepts, les enquêtes empiriques et les débats caractéristiques de ces transformations saillantes, les contributrices et contributeurs de cet ouvrage dessinent une cartographie critique des études de genre en ce début de XXIe siècle.
Matthieu CALAME
ECLM, 160 pages, 23 €
Popularisé en 2010 par Olivier de Schutter, alors rapporteur des Nations unies pour le droit à l’alimentation, le terme d’agroécologie a d’abord été utilisé pour désigner un modèle alternatif susceptible de répondre aux crises économiques, sociales et écologiques en conciliant les activités humaines avec les ressources planétaires. Il recouvre aujourd’hui une réalité encore floue, noyée dans une abondance de concepts cherchant à s’y rattacher.
L’objet de cet ouvrage est de fournir les clés pour comprendre de manière simple les processus biologiques et sociaux impliqués dans les modèles agricoles actuels, les limites avérées du modèle industriel et les principes d’un système alimentaire soutenable. En résumé, il s’attache à présenter les fondements de l’agroécologie.
Parce que la recherche d’un mode d’alimentation durable constitue un thème d’intérêt social majeur qui va bien au-delà des cercles d’experts, l’auteur souligne aussi l’urgence de replacer la question alimentaire au centre du débat public.
Écopunk. Les punks, de la cause animale à l’écologie radicale.
Fabien HEIN, Dom BLAKE
Le Passager Clandestin, 220 pages, 12 €
Vous vous déplacez plus volontiers à vélo qu’en voiture ; vous évitez de manger de la viande ; avec quelques amis, vous aspirez à vous installer à la campagne pour vivre de manière autosuffisante en pratiquant le maraîchage bio ; vous êtes révolté(e) par la destruction de la nature que justifient l’impératif consumériste et le productivisme effréné, et vous vous engagez d’ailleurs personnellement pour lutter contre tous les projets qui justifient ces logiques : vous êtes punk ! Ou pas loin…
Le punk rock est un formidable élan de créativité et d’énergie artistique qui se décline dans de multiples sous-genres. Mais c’est aussi une constellation d’idées et de pratiques collectives qui forment depuis les années 1980 un puissant mouvement contestataire, notamment sur le plan écologique.
Ce livre montre que la contre-culture punk, et en particulier son courant anarcho-punk, a eu, depuis plus de trente ans, une influence décisive dans la