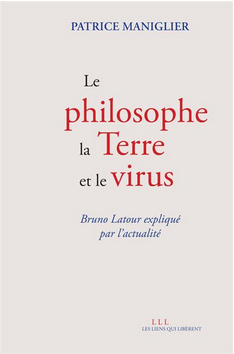Par Alain Coulombel
Le dernier essai de Patrice Maniglier intitulé « Le philosophe, la Terre et le virus »[1], sous titré Bruno Latour expliqué par l’actualité, est un vibrant hommage philosophique à la pensée latourienne. A partir de ce que la Covid-19 fait à notre situation de terrestre, Patrice Maniglier déploie son analyse autour de cinq dimensions, illustrant le bouleversement de nos cadres intellectuels, existentiels, politiques et métaphysiques.
Le premier chapitre « remettre les sciences au coeur du débat public » s’ouvre sur la dimension épistémologique (cadre intellectuel). Si la pandémie a remis les sciences au coeur du débat public, elle a aussi révélé la diversité des approches et les controverses agitant, dans l’espace public, les différents acteurs du monde scientifique. Les sciences ne détiennent pas à elles seules la vérité, « les sciences ne constituent qu’un régime de vérité parmi d’autres » (p.35), tout en contribuant à configurer notre réalité sociale.
Le second chapitre « mettre sur le même plan de réalité les humains et les non humains » traite de la dimension ontologique (cadre existentiel), en s’inscrivant dans les pas des travaux de Descola sur le naturalisme et la séparation « Nature/Culture ». La pandémie nous invite à repenser le cadre théorique actuel pour se déployer par delà nature/culture, autour du triptyque Horizontalité – Multiversalité -Agentivité, vers une ontologie plate considérant tous les êtres (vivant humain, non humain, virus, bactéries…) sur un même plan, comme puissances d’agir entrant dans des compositions ou des assemblages, composant différentes réalités. Reprenant la théorie de l’acteur-réseau de Bruno Latour, selon laquelle « toute action particulière est une synthèse entre plusieurs actions superposées » (p.53), Patrice Maniglier montre que nul n’agit, sans en même temps faire agir d’autres, tout actant étant déjà une alliance d’actants. « Il faut en somme remplacer le couple vivant-environnement (…) par l’idée d’une multitude de processus évolutifs par lesquels les acteurs se modifient et modifient les autres afin de les mettre au service de leur propre puissance » (p.56).
Le troisième chapitre « ramener sur Terre les Modernes » (dimension eschatologique) revient sur l’importance de Latour pour penser la séquence que nous traversons. Patrice Maniglier rappelle qu’il a été l’un des rares penseurs, ces dernières années, à clamer que la mutation écologique globale était « la question architectonique à partir de laquelle on devait fonder nos systèmes intellectuels aussi bien que nos formes de vie » (p.63). Si nous sommes terrestres, en effet, avant d’être humains, la pandémie nous montre qu’il est urgent d’atterrir, c’est à dire d’accepter que nos « existences n’ont pas d’autre horizon que la Terre ». La Terre est l’espace dans lequel nous sommes confinés et dont nous ne pouvons pas sortir (il n’y a pas de planète B), la pandémie nous rappelant que nous ne pouvons jamais nous séparer complètement des êtres qui nous entourent, que ces êtres soient vivants ou non-vivants. Avec la pandémie, nous butons sur des limites, des enchevêtrements entre des actants dont nous ne maitrisons rien. De ce fait, nos perspectives de développement ne sont plus illimitées, nos civilisations sont bien mortelles et ce qui les met en échec relève de la réaction d’un nouvel acteur, que l’on croyait jusque là passif, la Terre (« le cadre devient un acteur »). La fin n’est plus de l’ordre d’une éventualité mais « bien d’une nécessité résultant de nos actions », « il n’est plus question de savoir si nous saurons ou non nous arrêter avant la fin : nous serons arrêtés, que nous le voulions ou non » (p.75).
Le quatrième volet « penser la globalisation sans présupposer le globe » a trait à la dimension cosmologique du moment que nous traversons, dans la mesure où la pandémie est le premier évènement global de l’histoire humaine qui nous a synchronisé comme jamais, la manifestation de notre appartenance à la Terre comme réalité globale ou comme « ensemble de mécanismes qui se met en route du fait du réchauffement (…) ensemble très varié de phénomènes. Et on saura rendre compte de ces phénomènes à la fois dans leur diversité et dans leur unité que si on se rappelle qu’il y a un système climatique global – mieux, que le climat lui même fait partie d’un ensemble plus large et plus complexe encore, celui de la Terre » (p.102). Si la civilisation industrielle a déstabilisé ce système complexe qu’est la Terre, celui-ci recherchera, au prix de toutes sortes de transformations, qui peuvent aller de l’acidification des océans à la disparition du vignoble bordelais, un nouvel équilibre. Nous dépendons, en tant que terrestre, de ce principe de régulation.
Le cinquième chapitre « repolitiser la vie en revenant sur Terre » invite à une réflexion de nature géopolotique, en redéfinissant la politique comme géopolitique. En effet, avec l’introduction du terrestre dans nos existences, « la question n’est plus de savoir qui nous sommes, mais où nous sommes » (p.147), de combiner classes et territoires. La pandémie a mis en évidence, en mettant à l’arrêt certaines activités ou en soutenant une partie de l’appareil de production par l’intermédiaire de la dette publique, que l’économie pouvait être orientée par d’autres principes que ceux du marché. Que nous pouvions également profiter de cette période pour nous interroger sur le temps d’après, sur les activités à abandonner et sur les « nouveaux attachements que nous pourrions inventer » (p.150). Et réinscrire, de ce fait, l’économie dans la Terre. Car la pandémie ne sera un véritable évènement politique qu’à la condition de nous interroger sur la spatialisation de nos activités et sur le sens à donner à la notion de territoire. « On appelle territoire ce qui apparaît au moment où se présente un conflit de frontière (…) L’existence des territoires est donc différentielle et même plus exactement oppositive » (p.193). La formation d’un territoire nécessite donc la constitution dynamique, en opposition, de groupements sociaux fondés sur la solidarité mutuelle entre les termes rassemblés. Latour appelle ces groupements des classes géosociales [2]. Elles sont le résultat d’une lutte (comme la lutte des classes), à « l’intersection du politique (luttes), de l’économique (substance) et du culturel (stylisation de l’existence) » (p.216).
Mais si elles sont dites géosociales, c’est qu’elles impliquent non plus seulement des places dans l’appareil de production, « mais le partage de la Terre tout entière et les positions dans l’immense réseau des dépendances terrestres » (p.217). D’où la nécessité pour Latour comme pour Maniglier de ne plus se limiter à la sphère productive (le travail), mais de partir de la reterritorialisation des économies et de la terrestrialisation de nos existences. Car pour finir « la grande problématique qui structure la politique contemporaine parce qu’elle divise toutes nos expériences : non plus celle du régime de propriété (…) des moyens de production, mais celle de la relation des économies à la Terre qu’elle partage plus ou moins secrétement » (p.221).
Livre stimulant, parfois difficile, mais offrant à partir de l’expérience pandémique, une introduction à l’oeuvre de Bruno Latour et des pistes pour redéfinir toutes nos catégories en les ramenant sur Terre.
Alain Coulombel
[1] « Le philosophe, la Terre et le virus », Les Liens qui libèrent, 2021. Patrice Maniglier est philosophe, maitre de conférences à l’université Paris Nanterre.
[2] Voir Mémo sur la nouvelle classe écologique, Bruno Latour et Nikolaj Schultz, Les empêcheurs de penser en rond, 2022